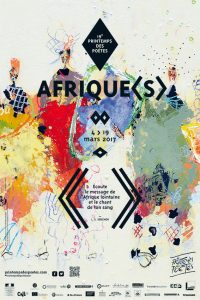A table!
C'était fin janvier, le week-end gourmand- gourmet en Camargue, joyeux souvenirs et quelques calories plus loin:
En abécédaires:
Auberge espagnole Biscornue et spéciale pour Carnivore Dégénéré Esprit es-tu là ? Fatigué ou bien ? Gargantua au goût affûté Herbivore mais pas que Inodore et incolore Juste ce qu’il faut Kaleidoscopique acrobatique et Lyrique Miss France Naguère Obèse Part Quelques jours se Restaurer Sans oublier d’emporter une Tarte citron meringue Une sorte de ragoût Vegan et un peu Wampire sur les bords avec un verre de Xerès bien en main Yoyo fait l’écho Zorro la rejoint
Djamila Boutin
Amandes Baignées dans du Calamondin, surtout pas de Dentier qui tombe dans l’assiette et servant d’Ecumoire pour les Frites. Avant le Gâteau, le Homard à l’armoricaine plein d’Ingrédients Juteux (Kiwis … ), pas besoin de Livre de cuisine pour les Moules ni les Nouilles, sur ces dernières un peu d’huile d’Olive, quelques Pruneaux pour faire passer tout ça. Après la Quiche, un Rizotto Sauce aigre douce. Allez, une Tarte au thon : dans cet Univers culinaire trouver les Vins associés mais attention à la cuisine de Virus type « Wuhan ». Il vaut mieux du vin de Xérès sans Yaourt ni Zus de citron.
Gilbert Benony
Des Je me souviens... en méli mélo...
Je me souviens de l’arrivée triomphale du grand plat jaune d’où dépassaient la tête et la queue d’un loup de 5 kilos pêché par mon père, servi traditionnellement le soir de Noël.
Je me souviens d’entendre de la salle à manger, le fou rire de ma mère, à quatre pattes dans la cuisine en train d’essayer de ramasser la tarte Tatin explosée au sol lors de son retournement.
Je me souviens du mon fou rire devant mon mon gâteau au chocolat en forme d’éboulis suite à sa glissade tout au fond du four alors qu’il n’était qu’à moitié cuit.
(...)
Je me souviens d’une daube cuite dans une lessiveuse pour les 50 ans d’Antoinette à Auriol
Je me souviens du tube Nestlé quand il fallait le rouler pour en extraire les dernières gouttes
Je me souviens des zlabias qui avaient la couleur orange des cheveux de ma cousine Babette
Je me souviens que papy découpait ma tranche de jambon en morceaux égaux sans en modifier la forme, prouesse de géométrie
(...)
Le parti-pris d'une gousse d'ail...
La gousse d’ail se couvre d’une robe argentée, effilochée un peu, retroussée, insolente. Sous la robe, les flancs inclinés, une peau douce et rose, montent se rejoindre en une queue frisée. Ils enferment la chair. Sans la voir, on devine pourtant sa blancheur odorante. Un germe y pousse comme un foetus caché. Le débusquer serait couper la gousse, l’éventrer, la violenter. Elle livrerait son anatomie, deux lobes denses à l’odeur entêtante prête au sacrifice sur l’autel de notre gourmandise.
Sabine Boilot
Les suppliciés de Mimi
Avec la cruelle minutie de vos patientes mains
Les blancs artichauts vous effeuillerez
Dans l’acidité d’un bain citronné les blanchirez
Puis dans la vapeur bouillante vous les attendrirez
Olives, fines herbes et écorces d’orange vous molesterez
Et dans un piquant onguent d’ail et d’huile d’olive les oindrez
De jeunes champignons juste éclos vous décapiterez et lacèrerez
De vos doigts crochus, le tout malaxerez
En boules de la taille d’une noix que vous aplatirez
Dans les culs d’artichauts vous les dresserez
Et d’une perruque de gorgonzola vous les affublerez.
Puis à four brûlant vous les crématiserez
Et encore croustillants sifflants éructants vous les dresserez
sur le grand plat d’argent que vous aurez fait briller
au centre de l’autel sacrificiel de la table à manger.
Elisabeth Duret
Jouer les filles de l'air...
Le souffle appliqué
Sur les ailes du silence
Le crayon résonne
L’air est parcouru
D’invisibles particules
Flotte l’égrégore.
Elisabeth Duret
Mes cheveux s’envolent
Caressés d’un souffle court
Echappé de toi.
C’est la vie qui naît,
C’est la vie qui meurt aussi
Que ce souffle là
Sabine Boillot
Les quatre éléments
« Je cours sur la plage de chenoua (....) je cours avec la mer qui monte et descend sous les ruines romaines, je cours dans la lumière d’hiver encore chaude, je tombe sur le sable, j’entends la mer qui arrive ..... »( Nina Bouraoui, Garçon manqué )
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher
Des guirlandes de fenêtre à fenêtre
Des chaînes d’or d’étoile à étoile
Et je danse »
Mes pas m’ont amenée sur le rivage, sur l’immensité déserte de cette plage, au crépuscule. J’ai laissé derrière moi un ruban parsemé de lumières éclairant les rues et les maisons, et j’ai noyé mon regard dans les lueurs rosissantes du ciel sans nuages. Mes pieds ont effleuré le sable vierge lissé par le ressac, ils ont ressenti la fraîcheur de l’eau et la douceur des minuscules bulles d’écume.
Je me suis prise pour Vénus émergeant de l’océan, et un élan irrépressible s’est emparé de tout mon être, de la pointe de mes orteils à la racine de mes cheveux.
Et maintenant, je ne suis que mouvement, courbures et contorsions, je m’enivre du vent du large qui fait flotter ma chemise, s’envoler ma chevelure, apporter sur mes lèvres la saveur salée des embruns, et à mes narines la senteur iodée de la mer.
Mes traces sur le sable s’effacent à chaque vague qui s’étale langoureusement, j’avance, je recule, je me penche et n’en finis plus de tournoyer, lancer mes bras vers le ciel ou vers l’élément liquide qui m’appelle et m’attire à lui.
Mais je veux encore profiter de la liberté que j’ai dans l’air tiède de cette fin de journée, jusqu’au vertige, le vertige de l’oubli au contact de l’eau qui vivifie et apaise tout à la fois, le vertige né de la danse, muée en transe, une transe d’où l’on ne revient qu’après avoir épousé l’horizon.
Claudine
 "Le feu est douceur et torture. Il est cuisine et apocalypse… Le feu est beau en soi, n’importe comment. " Klein
"Le feu est douceur et torture. Il est cuisine et apocalypse… Le feu est beau en soi, n’importe comment. " Klein
Carton brûlé sur panneau
250 x 130 cm
Immolation
Farce stupide
dernières bulles puantes
La pluie en bruine la nuit ocre
L’ombre en fuite apparaît d’abord,
se redresse aussitôt,
fonce au pas gymnastique,
disparaît définitivement dans la nuit
Papa s’était sans doute levé
Maman n’était pas là
Pas de réponse
Papa était parti
Affolés les gens se mettaient à courir pieds nus
inutiles mais soucieux devant le feu
Les gens ralentissaient,
s’approchaient,
avouaient c’est beau
c’est tragique
on n’a jamais vu ça
Deux voisins venaient de disparaître,
consumés
La nuit redevint parfaite
à peine trouée par la vieille lampe tempête
Les vaches hochaient la tête,
mais ne pipaient mot.
Elisabeth
Eté 2022... traces
Tout d’abord, apparemment, et même assurément, il a fait chaud, très chaud. Un été caniculaire comme jamais depuis 1947 disaient certains média. Une canicule à laquelle il allait falloir s’habituer puisque 2022 demeurera « l’été le plus frais du reste de notre vie ». Est-ce une formule choc des journalistes pour faire sensation ?
La réalité c’est que les incendies ont embrasé les forêts, que partout la faune a péri pendant que nous augmentions le niveau de la clim dans nos véhicules. Balade en forêt. Tout est sec, trop sec. Orages diluviens annoncés, on ne reçoit que quelques pauvres gouttes d’eau. Les arbres deviennent avides, leurs feuilles réclament de l’humidité, pompent goulûment les trop rares ondées. Partons vers des altitudes plus élevées où, au moins, nous parviendrons à dormir. Désertons l’intérieur du pays provençal pour la montagne noire. Retraite hors du monde et de son agitation. Mais ici aussi, à 1000 mètres d’altitude, on peut constater les dégâts de la sécheresse. Certains arbustes aux racines trop frêles ont littéralement séché sur pied et présentent déjà les couleurs de l’automne. Les animaux s’approchent des cours d’eau. Comme eux, nous traquons les lacs et leur relative fraîcheur : 26 degrés pour un lac de moyenne montagne. Catastrophe halieutique.
La quête de l’eau a commencé. Guerre du climat sur fond de guerre en Ukraine et de tant d’autres drames qui ont donné un goût amer à cet été 2022.
.Isabelle
Tout d’abord, apparemment, on allait en baver, en suer, en pleurer de chaud. Le sujet était incontournable et à la fois lassant. Envie de parler d’autre chose sans se laisser rattraper par la prégnance de la température ambiante. Envie d’échanger tout simplement le vrai du fond de nous, loin des poncifs ambiants rabâchés sur France inter dès le 5/7 pourtant épargné par la canicule. Bien étrange cette réaction qui projetait certains ailleurs, loin derrière, « Je me rappelle quand » …ou « tu te souviens ? » En fait c’est de fuite qu’il s’agissait une fuite merveilleusement emballée dans le tissu chatoyant de nos souvenirs. Jamais tant entendu les histoires de chacun sur la douceur de l’air, autrefois, quand il était petit, quand il installait dans la fraîcheur du soir son pliant, sur la terrasse aux dalles tièdes. Jamais tant entendu le rappel des maisons autrefois en Provence, quand on croisait les volets et qu’aucun bruit de climatiseur ne gâchait la sieste.
La nostalgie nous a sauvés, tous ailleurs dans nos mondes respectifs, l’œil posé en coin sur le mercure du thermomètre.
Sabine
Tout d’abord, apparemment, tout avait commencé comme d’habitude. Les journées s’étaient étirées, le soleil s’était imposé et avec lui, les cigales coutumières des étés méditerranéens. Et puis, le « trop » s’était installé : trop de chaleur devenue canicule, trop de moustiques-tigres aux piqûres aussi violentes que l’insecte est invisible, trop de sécheresse jaunissant champs et pelouses interdites d’arrosage, trop d’informations alarmantes après avoir été alarmistes, trop de feux de forêts gigantesques ici ou là, partout dans l’Hexagone et au-delà de nos frontières, sans compter les feux de la guerre, lointaine et proche à la fois, avec ces nouveaux migrants venant s’ajouter à tous ceux, désespérés en quête d’espoir, du continent africain. Cela devait durer tout l’été, heureusement ponctué de pauses bienvenues au-delà de la commune et même du département, propres à me faire oublier pendant quelque temps les inconforts du quotidien. Elles eurent aussi pour effet d’augmenter l’amer regret d’avoir décliné les invitations à me rendre en montagne, là où les nuits sont plus fraîches que les jours et où l’herbe est plus verte qu’en plaine. L’été prochain, me promis-je, l’été prochain, je ne referai pas la même erreur, quand les canicules séviront de nouveau, que les feux reprendront, puisque les humains sont décidément, définitivement déraisonnables… Indécrottables, aurait renchéri notre professeur de mathématiques en classe de 1ère ! Appliqué à notre nullité supposée en sa matière, l’adjectif nous faisait bien rire ; dans le contexte actuel, il ne me fait plus rire du tout, mais alors, plus du tout !
Claudine
 Apparemment l’été sera chaud. Déjà en Mai l’évidence est là ! Changement climatique, températures caniculaires, restrictions d’eau, sècheresse, incendies, autant de termes qui font le quotidien à la une des informations. La liste est longue pour s’enfoncer dans une morosité sans fin. En fond de ce tableau, la violence des guerres, en Ukraine et ailleurs dans le monde… un terrain chaotique pour la presse où certains se délectent. S’échapper, partir à la montagne pour un peu de fraîcheur. Que la montagne est belle ! Sous les mélèzes les campeurs apprécient chaque instant à l’air libre. Fini l’enfermement ! Les randonnées vers les sommets sont un délice. Oublié le vacarme mondial ! D’innombrables fleurs multicolores, la danse des papillons, le cri des marmottes et le chant des torrents sont maintenant sur le devant de la scène et enrichissent nos journées. Un orage imprévu, une coulée de boue assez impressionnante avec ses blocs de roche et tout le village se mobilise. Chacun est à la tâche pour déblayer la route. Quelques bavardages autour du phénomène, personne n’a trop envie de s’étendre mais chacun sait que ces décrochages de la montagne se répètent de plus en plus souvent. Ambiance solidaire, chaleur humaine, partage… on prend de la hauteur et que ça fait du bien ! Plus tard dans l’été interminable le port et le bateau qui nous emmènera sur l’île assaillie cette année. Comme ils disent à la radio, les destinations sont plus proches, moins d’exotisme, plus de simplicité. Les touristes pour la plupart restent sur la côte pour profiter de la baignade. Notre village accroché à la montagne reste calme et silencieux. Nous apercevons la mer au loin mais pas les vacanciers. La vallée au-dessous respire et nous respirons avec elle. Il y a toujours un petit vent dont nous savourons le souffle bienveillant. Les couchers de soleil sont sublimes. Peu de réseau, plus de nouvelles ! Le silence, un rapace qui tournoie dans le ciel, quelques chèvres et leurs chevreaux qui passent paisiblement, le ciel étoilé le soir, une chauve-souris au vol furtif qui se faufile d’un toit à l’autre… comme si de rien n’était.
Apparemment l’été sera chaud. Déjà en Mai l’évidence est là ! Changement climatique, températures caniculaires, restrictions d’eau, sècheresse, incendies, autant de termes qui font le quotidien à la une des informations. La liste est longue pour s’enfoncer dans une morosité sans fin. En fond de ce tableau, la violence des guerres, en Ukraine et ailleurs dans le monde… un terrain chaotique pour la presse où certains se délectent. S’échapper, partir à la montagne pour un peu de fraîcheur. Que la montagne est belle ! Sous les mélèzes les campeurs apprécient chaque instant à l’air libre. Fini l’enfermement ! Les randonnées vers les sommets sont un délice. Oublié le vacarme mondial ! D’innombrables fleurs multicolores, la danse des papillons, le cri des marmottes et le chant des torrents sont maintenant sur le devant de la scène et enrichissent nos journées. Un orage imprévu, une coulée de boue assez impressionnante avec ses blocs de roche et tout le village se mobilise. Chacun est à la tâche pour déblayer la route. Quelques bavardages autour du phénomène, personne n’a trop envie de s’étendre mais chacun sait que ces décrochages de la montagne se répètent de plus en plus souvent. Ambiance solidaire, chaleur humaine, partage… on prend de la hauteur et que ça fait du bien ! Plus tard dans l’été interminable le port et le bateau qui nous emmènera sur l’île assaillie cette année. Comme ils disent à la radio, les destinations sont plus proches, moins d’exotisme, plus de simplicité. Les touristes pour la plupart restent sur la côte pour profiter de la baignade. Notre village accroché à la montagne reste calme et silencieux. Nous apercevons la mer au loin mais pas les vacanciers. La vallée au-dessous respire et nous respirons avec elle. Il y a toujours un petit vent dont nous savourons le souffle bienveillant. Les couchers de soleil sont sublimes. Peu de réseau, plus de nouvelles ! Le silence, un rapace qui tournoie dans le ciel, quelques chèvres et leurs chevreaux qui passent paisiblement, le ciel étoilé le soir, une chauve-souris au vol furtif qui se faufile d’un toit à l’autre… comme si de rien n’était.
Françoise
 CALIENTE 2022 aux Lecques Tout d’abord apparemment nous allions vers un été libéré des contraintes sanitaires de 2019, 2020 et 2021. Liberté et amitié, les retrouvailles, les routes, les trains, les avions, les embrassades, les fêtes, les foules, tout était ouvert. Les commerçants balnéaires se frottaient les mains, les plages privées se sont fait une beauté pour leur réouverture, déco de paille, de bambou et de bois exotique. L’été se présentait plein d’espoir. Le mois de juin fut chaud, les bacheliers ont souffert pour leur révision et leurs examens. Les trains étaient remplis bien à l’avance, pas facile de trouver un billet. Il y eut énormément de monde sur les routes. Jamais la Méditerranée n’a été aussi « bonne », mais bonne pour qui ? Pour les baigneurs, les nageurs, les barboteurs, les lanceurs de balles et joueurs de raquettes. Enfin, pour les chanceux qui ont pu trouver une place de parking! Nous, la chance, on n’a que la rue à traverser pour être à la plage, donc tous les matins tôt, à l’heure des bébés tant qu’ils ont la place de construire des châteaux de sable, nous allions jouer au ballon jusqu’à la ruée de 11h. Mais les fonds sous-marins ont pâti de cette chaleur, de cette huile solaire dégoulinante des corps transpirants, des bruits de moteurs, des gaz et fuites de carburant, des remous et du saccage des ancres de la pléiade de véhicules marins. On dirait que tout est motorisé à présent, sur terre et sur mer, les trottinettes, vélos et même les planches de surf s’équipent. L’homme deviendrait-il assisté et handicapé, à chercher toujours plus de déplacements et plus de vitesse à moindre effort ? Et que dire de l’addiction au téléphone portable et aux écouteurs même pendant la baignade ? Hormis la navigation silencieuse et élégante des paddles et kayaks, des Optimists, catamarans et planches à voiles au milieu du tumulte, la baie est labourée des sillages de skis nautiques, bouées géantes, skurfs, jet-skis, hors-bords, et le ciel labouré de parachutes ascensionnels, ULM, longs courriers et hélicoptères de secours… et chaque midi, passe un bimoteur traînant une bannière publicitaire, réminiscence de notre enfance. C’était le poulet Cassegrain à l’époque, et là c’est pour la chaîne de magasins GIFI. Ma promesse quotidienne de cet été 2022 aura été de ne jamais y mettre les pieds.
CALIENTE 2022 aux Lecques Tout d’abord apparemment nous allions vers un été libéré des contraintes sanitaires de 2019, 2020 et 2021. Liberté et amitié, les retrouvailles, les routes, les trains, les avions, les embrassades, les fêtes, les foules, tout était ouvert. Les commerçants balnéaires se frottaient les mains, les plages privées se sont fait une beauté pour leur réouverture, déco de paille, de bambou et de bois exotique. L’été se présentait plein d’espoir. Le mois de juin fut chaud, les bacheliers ont souffert pour leur révision et leurs examens. Les trains étaient remplis bien à l’avance, pas facile de trouver un billet. Il y eut énormément de monde sur les routes. Jamais la Méditerranée n’a été aussi « bonne », mais bonne pour qui ? Pour les baigneurs, les nageurs, les barboteurs, les lanceurs de balles et joueurs de raquettes. Enfin, pour les chanceux qui ont pu trouver une place de parking! Nous, la chance, on n’a que la rue à traverser pour être à la plage, donc tous les matins tôt, à l’heure des bébés tant qu’ils ont la place de construire des châteaux de sable, nous allions jouer au ballon jusqu’à la ruée de 11h. Mais les fonds sous-marins ont pâti de cette chaleur, de cette huile solaire dégoulinante des corps transpirants, des bruits de moteurs, des gaz et fuites de carburant, des remous et du saccage des ancres de la pléiade de véhicules marins. On dirait que tout est motorisé à présent, sur terre et sur mer, les trottinettes, vélos et même les planches de surf s’équipent. L’homme deviendrait-il assisté et handicapé, à chercher toujours plus de déplacements et plus de vitesse à moindre effort ? Et que dire de l’addiction au téléphone portable et aux écouteurs même pendant la baignade ? Hormis la navigation silencieuse et élégante des paddles et kayaks, des Optimists, catamarans et planches à voiles au milieu du tumulte, la baie est labourée des sillages de skis nautiques, bouées géantes, skurfs, jet-skis, hors-bords, et le ciel labouré de parachutes ascensionnels, ULM, longs courriers et hélicoptères de secours… et chaque midi, passe un bimoteur traînant une bannière publicitaire, réminiscence de notre enfance. C’était le poulet Cassegrain à l’époque, et là c’est pour la chaîne de magasins GIFI. Ma promesse quotidienne de cet été 2022 aura été de ne jamais y mettre les pieds.
Elisabeth
Tonnerre de Brest ...
Depuis quelque temps, déjà, la Bretagne se rappelait à lui, par bribes. Des petits riens qui le faisaient tressaillir. Il se disait alors qu’il était temps d’y retourner, de réveiller ses gènes bretons, et de les laisser s’exprimer, à nouveau. Faire de la place à cette lumière si particulière, ces nuances infinies de gris et de bleu. Laisser l’odeur du goémon lui chatouiller les narines. Retrouver une certaine part d’enfance, et la laisser agir comme une marée montante. Puis reprendre le fil de la vie, et pourquoi pas la course de la vie…même s’il avait bien compris qu’il lui faudrait maintenant mieux gérer tout cela.
Il avait mené sa carrière professionnelle à grandes enjambées, sautant d’un continent à l’autre. Il avait connu le succès, et même une certaine renommée dans le monde des architectes. Il avalait tout, les différents fuseaux horaires, la pression des appels d’offre, puis celle des chantiers. Il semblait indéboulonnable. Jusqu’à ce jour de juillet où il n’avait pas réussi à sortir de son lit. Son corps, jadis d’acier, lui semblait tout d’un coup tout effrité, et ne répondait plus. Le diagnostic était tombé, implacable : Burn Out. Un corps et un esprit à marée basse, des idées sans suite qui se succédaient, une volonté dont le gouvernail ne répondait plus.
A une vie trépidante avait succédé un temps de pause obligatoire. Il ne gardait aucun souvenir des premiers temps, il se souvenait seulement que son esprit mâchouillait du gris, inlassablement. Rien n’arrivait à s’accrocher durablement dans son cerveau épuisé. Jusqu’à ce jour de juillet où sa femme, en ouvrant les volets comme chaque matin, lui avait demandé : « à quoi penses-tu ? ». A sa grande surprise, il avait répondu : « A une gorgée de bière fraîche ». Il avait ajouté, quelques minutes plus tard : « et à tout ce que je n’ai pas eu le temps de faire ces 30 dernières années ! Si on partait tous les deux, à Quimiac ? »
Dominique
Une affaire à suivre...
De marées...
Elle avait soif. Il avait fait si chaud cette nuit. Elle a bu cette bouteille jusqu’à la dernière goutte. Son gosier a réveillé ses sens comme des fleurs desséchées qui reprennent vie. L’estomac a accueilli la fraîcheur et tout le bas du corps a répondu par une onde satisfaite. Le jour commençait à poindre. Dehors, les arbres affichaient leurs feuillages sur le fond clair. La matinée allait être nuageuse.
Elle a posé cette fiasque de verre et retourné l’étiquette : la bière s’appelait « Nuit blanche ». Six heures du matin, il n’y avait plus que ça dans le frigo. Elle ne s’était même pas couchée. Dans la chambre, le lit était resté fait, les oreillers posés et non froissés. Elle n’avait ni dormi, ni pris la moindre minute pour s’allonger.
Il fallait qu’elle écrive. Il ne fallait pas rater çà, sinon, ce serait comme un rêve qui disparaît après le réveil. Il fallait donc cette nuit blanche à bannir le sommeil pour raconter tous ces événements. Elle avait tellement peur de l’oubli. Elle avait donc écrit toute la nuit, d’un seul jet, sans trop se rendre compte des heures calmes qui passaient. A présent, c’était le jour. Les nuages étaient là comme prévu. Elle est sortie. Il lui fallait un peu d’air et de mouvement pour répartir le breuvage dans son corps alourdi. Elle a pris le sentier sablonneux de la plage.
Dans la petite baie, il n’y a personne. La marée a commencé son chemin descendant. Il y a des bateaux qui reposent sur leurs dérives et gouvernails, comme de gros poissons sur leurs nageoires. Elle, la méditerranéenne, elle n’a pas souvent vu ça, et en tous cas, comme ici, jamais. Elle s’est dit que c’est un beau spectacle et qu’elle aurait pu mourir idiote de ne jamais l’avoir contemplé. Elle est seule ici. Dans la petite baie, sur cette plage, il n’y a personne. Elle se dit qu’un observateur l’aurait vite repéré. Elle pense à Vendredi sur l’île de Robinson Crusoé.
Si elle pouvait, elle se mettrait à courir, mais il y a le poids de cette nuit blanche. Elle a longé la route qui arrive là. Elle va chercher un commerce ouvert. Pourtant, il est encore tôt. Dans la rue, bien sûr, tout est fermé. Heureusement, il y a des vitrines. C’est là qu’elle s’arrête devant cette galerie d’arts avec cette sculpture qui représente un homme qui court. Il est tout constitué d’écrous hexagonaux. C’est cette étrange table de six qui prend la fuite devant elle, sans bouger. Tout à l’heure, elle voulait courir et le voilà lui, ou elle pourquoi pas, qui détale dans son costume de quincaillerie.
Elle sourit intérieurement. Flâner, ça donne parfois des idées. Est-ce qu’elle va écrire ça aussi ? Elle aurait bien besoin de se mettre quelque chose dans le ventre. Elle se sent un peu engourdie. Ça la prend autour des yeux et dans les chevilles. Elle n’a pas d’autre choix que de revenir. La revoilà sur la petite grève. Ce n’est pas possible la vitesse de la marée. Les bateaux sont maintenant tous des échassiers avec leurs becs et leurs pattes dans la vase. Leurs ventres sont à l’air. Un pâle soleil s’est levé et éclaire quelques façades. Elle n’est plus seule, elle a vu d’abord que d’autres traces que les siennes se sont imprimées dans le sable, puis elle a vu les deux types penchés sur les flaques d’eau. Des pêcheurs à pieds, elle n’en avait jamais vus, ça non plus. Que peuvent-ils rechercher ? Est-ce qu’ils vont attraper des palourdes ? Pour un peu, elle aurait envie de spaghettis, avec ces coquillages, bien al dente, comme les aime son amie sicilienne ; elle fera exception aujourd’hui ; dans sa famille napolitaine, on les préfère plus tendres et plus cuits. Elle n’ose pas aller leur parler. Elle n’a que ses palourdes dans la tête, pas des vers d’appâts.
Elle revient à la maison, elle aime bien cette tour, ça lui rappelle celle où Montaigne avait placé sa librairie, avec le trou pour évacuer sur les murs, en ces temps où les chasses d’eau n’existaient pas et cet autre orifice-fenêtre, vers la chapelle, pour assister incognito à la messe. Elle n’a pas oublié ça, elle qui écrit systématiquement tout, elle ne l’a jamais noté, mais c’est resté dans sa tête. Si elle pouvait, elle monterait l’escalier, on lui a dit qu’il faisait 72 marches, tiens c’est aussi un multiple de six, pour accéder à la terrasse là haut.
Il fait grand jour à présent, sur le mur aveugle, peut-être le pignon nord, il y a cette affiche avec l’oiseau de nuit qui dit : A quoi tu penses ? Ce n’est pas compliqué est-elle tentée de lui répondre, je viens de l’écrire, là…
Puis, elle a vu le pigeon qui regarde cette chouette de papier.
Pourquoi, ne se métamorphoserait-elle pas en pigeon ? A vrai dire, après cette nuit blanche et cette petite promenade, elle est pleine de messages.
Gérard
Armorique
Il n’y a personne. J’ai perdu encore quelques écrous. Je m’enfuis avant l’ouverture, vite, ils vont arriver. Le jour se lève et me fait miroiter et disparaître peu à peu.
Je suis le Fantôme Mécanique, l’âme de ce hangar autrefois dédié à la réparation des moteurs de barques, tracteurs et autres engins agricoles. Avant, lorsqu’il n’y avait que des fermes autour du village. Avant l’immigration massive des urbains, avec leur style industriel à la noix qui a conduit au feu tous les bahuts buffets armoires sculptées lits clos tables et bancs de chêne, fauteuils robustes où l’on ne pouvait s’asseoir que bien droit…
Je suis le fantôme créé par les vraies mains pleines de cambouis des industrieux, ces rougeauds en salopettes et casquettes crasseuses qui de génération en génération m’ont construit, assemblé, soudé, fantôme-fantasme à la silhouette élancée et musculeuse d’un Spiderman, héros mille fois redessiné, plus grand que la moyenne des gars du village.
Et me voilà planqué dans ce chantier naval, où le plastique a remplacé les bordées de bois, le Kevlar et l’aluminium les voiles latines couleur de rouille, les odeurs d’essence le bruit des rames. Il y a plein d’écrous dans des petits tiroirs, du bel et bon inox, j’en choisis quelques-uns, dans le fol espoir qu’un jour, peut-être…
Le temps lui n’a pas changé au cours des siècles, nuages et marées, en-dessus et en-dessous la multiplication des habitations et embarcations. Des gens d’ici qui m’ont connu au fond de l’atelier, il n’en reste peu, et dans leurs vieilles mémoires j’existe encore, la fierté du village, bien cachée du rare public de l’époque.
Dans la journée c’est en forêt que j’habite, avec mes amis les oiseaux. Perchoir scintillant, j’abrite leurs amours. A la tombée de la nuit, la hulotte ouvre ses grands yeux et me demande « À quoi tu penses ? ». Elle, c’est à son dîner urgent qu’elle pense, elle n’a rien avalé depuis la nuit précédente. Elle pense à ses œufs bien au chaud dans son ventre, à son nid douillet prêt à les accueillir incessamment. Elle et moi rôdons la nuit, tandis qu’elle vole parmi les arbres et les buissons, je parcours mes souvenirs.
La nuit est blanche sous la pleine lune. Festoient les fantômes, planent les écrous, le faucon-bélier rejoint les noctambules, la bière coule à flots dans les réminiscences des fêtes d’antan. Forêt de Brocéliande, le profane se frotte au sacré, résonnent les binious et tapent les sabots. Les êtres magiques sont de sortie, les anciens arborent les masques mythologiques des rituels renouvelés. La nuit est blanche, longue et secrète en cette grande marée.
Au matin les bateaux flottent, la plage est déserte, le temps n’a pas changé, gris et doux. C’est dimanche, la pleine mer attend ses ouailles, à voile et à moteur, cirés jaunes dans tout ce gris bleu vert beige, sous le vol immaculé des mouettes et goélands. Nul ici ne se doute de notre présence sous les feuillages et dans les canopées alentours, nul ici ne se doute de nos rendez-vous nocturnes mensuels tandis que les écrans les hypnotisent et les bistrots les alcoolisent.
Cette nuit, j’ai regagné quelques écrous, la hulotte a pondu et dort sur ses œufs, tandis que les oiseaux de la forêt volètent à travers ma silhouette creuse en piaillant de joie et de désir.
Elisabeth
Atelier nomade avril 2022, "Passage de la mode"
L'invitation durant ce week-end à écrire autour de l'idée du vêtement, celui d'hier et d'aujourd'hui, le nôtre ou celui de l'autre pour, entre « projets, finitions, coupes et corrections » tisser les mots de vos saisons...
Des Je me souviens, à la manière de Perec...
Je me souviens de cet ensemble Cacharel troué en trébuchant la première fois que je le portais.
Je me souviens du regard scandalisé de ma grand-mère à la vue de la culotte rose fuschia portée sous ma robe de mariée.
Je me souviens de cette mini-robe sexy en mohaire noir que je mettais en frigo pour la préserver.
Je me souviens du magazine 100 idées et de ses modèles faciles et gais que je cousais et tricotais pour mon bébé.
Je me souviens des jolies culottes à trous trous tricotées par mon arrière-grand-mère, dont j’avais honte.
Je me souviens de ce chandail tricoté avec les laines détricotées de pull-overs de mon père.
Je me souviens de ce même pull s’arrachant des filières du voilier et se perdant dans l’océan.
Je me souviens de l’atelier de couture de ma grand-mère d’où sortaient à chaque saison les nouvelles tenues des bourgeoises marseillaises.
Je me souviens du carton de bouts de tissus somptueux de toute une vie de couturière.
Je me souviens des robes racontées avec mille détails et anecdotes pour chacun de ces bouts de tissus exhumés.
Je me souviens des vêtements excentriques, et les chaussures aussi, de ce magasin soldant les grandes marques.
Je me souviens des vêtements improbables chinés aux Puces ou au vide-grenier, veste noire en cuir et peau de chèvre, perfecto en skaï rouge…
Je me souviens de cet immense pull gris-vert à torsades piqué à mon mari et porté encore longtemps après le divorce.
Je me souviens des années en uniforme jean 501 délavé et pull noir moulant.
Je me souviens des tricots de peau – maillots de corps – marcels et des slips kangourous de mes petits frères.
Je me souviens des combinaisons en nylon sous les robes.
Je me souviens de mes tabliers d’écolières, uniformes bleu marine à croquet blanc à l’école religieuse puis blouses en nylon bigarré à l’école communale.
Je me souviens d’avoir entendu que j’étais plus belle nue que vêtue. Je me rappelle de l’odeur des magasins de tissu à nulle autre pareille, odeur feutrée parfumée de naphtaline .
Je me rappelle des culottes courtes de mes frères et des jupes plissées de ma sœur et moi, pas le droit de porter des pantalons longs avant le collège.
Je me rappelle des barboteuses brodées à la main, des robes à smocks et à dentelle de ma toute petite enfance.
Je me souviens de toutes les couleurs à la mode qui se supplantaient chaque année.
Je me souviens de mains timides glissées sous le bord des vêtements. Je me souviens des tas de vêtements éparpillés en hâte au pied du lit. Je me souviens de la machine à coudre offerte par ma belle-mère après le divorce.
Elisabeth
Je me souviens du blue- jean que me piquait ma sœur régulièrement.
Je me souviens que je râlais « tu vas encore me l’élargir ».
Je me souviens de l’émotion que provoque l’achat du premier soutien gorge.
Je me souviens de la robe rose en laine offerte par mon père quand j’ai six ans.
Je me souviens que j’étais plutôt un garçon manqué à cheveux courts et pantalons.
Je me souviens de la photo de Marilyn M. dont la robe se soulève au dessus d’une bouche de métro.
Je me souviens que j’avais appris à faire un noeud de cravate pour je ne sais quelle cérémonie.
Je me souviens des vêtements qualifiés de hippie chic que porte Diane Keaton dans le film de Woody Allen « Annie Hall ».
Je me souviens des commentaires sur la robe que portait Cécile Duflot nouvellement nommée au gouvernement.
Je me souviens de la coquetterie flamboyante des femmes d’Afrique de l’ouest.
Je me souviens que je me trouvais vraiment moche à côté d’elles avec mon short tout fripé.
Je me souviens de mains tâtonnantes dans le noir qui cherchent l’attache de mon soutien gorge.
Je me souviens de mains plus expertes qui elles ne cherchent pas.
Je me souviens qu’une copine m’a raconté le plaisir charnel de ne pas porter de culotte. Et celui aussi de ne pas porter de soutien gorge.
Je me souviens qu’on dit d’une femme qu’elle a « une tête à chapeau ».
Je me souviens que Brigitte Macron porte toujours des robes ou des jupes qui lui arrivent au dessus du genou.
Je me souviens de mon fils qui recouvrait son crâne de la capuche de son sweat souvent noir comme tous les adolescents.
Je me souviens d’un beau pull en cachemire porté une seule fois car lavé trop chaud.
Je me souviens que Céline Dion a déclaré posséder plusieurs centaines de paires de chaussures.
Je me souviens que les Guignols de l’info représentaient la femme de Jacques Chirac la main crispée sur son sac à mains
Djamila
Je me souviens du corset de ma grand-mère qui faisait ressortir les bourrelets de graisse.
Je me souviens des vêtements de travail de mon père épais et tachés de sang.
Je me souviens de l’horrible casquette que je devais porter à l’école.
Je me souviens du pantalon d’hiver en tissu qui grattait et que ma mère repassait systématiquement.
Je me souviens de la tunique rouge cousue par ma sœur et que je portais pour le spectacle de Noël.
Je me souviens d’une robe bleue transparente dans laquelle tu étais nue.
Je me souviens de tes gants en cuir dont les bouts sont coupés pour le vélo.
Je me souviens de ta jupe colorée et fleurie que tu faisais flotter en descendant l’escalier.
Je me souviens du string qui me faisait déglutir un instant.
Je me souviens de l’anorak dont la fermeture éclair coince systématiquement et que je garde pourtant.
Je me souviens de la photo où ma sœur et moi portons des costumes bretons rien que pour le cliché.
Je me souviens des slips féminins de dimensions surnaturelles séchant sur le fil à linge de la voisine.
Je me souviens des pièces en plastique que ma mère collait avec le fer à repasser aux coudes de mes pulls usés. Je ne me souviens plus de ce que je portais le 11 septembre 2001.
Je me souviens des difficultés à dégrafer les attaches de soutien-gorge.
Je me souviens des casquettes horribles que portait mon père.
Je me souviens des premières chaussures à bouts pointus que je portais à l’époque « yéyé ».
Ben
Je me souviens de sa robe fuschia et de ses bras nus au hâle si parfait et si lisse. Dans les tribunes du Palais Bourbon, un jour du printemps de 1976, l’étudiant que j’étais écoutait Simone Veil défendre son projet de loi anti-tabac.
Je me souviens de mes pieds mouillés ce matin d’été, dans les champs près du Mont-Blanc. Mes baskets neuves ne résistaient pas à la rosée.
Je me souviens de la fourrure du manteau de ma grand’mère que j’aimais caresser.
Je me souviens de la tache de tapenade sur mon pull-over.
Je me souviens de la brûlure sur ma veste et des cendres de ces cigarettes.
Je me souviens de la déchirure et du trou à mon genou dans la flanelle, après une chute sur le terrain de foot.
Je me souviens des craquements de mon short trop petit.
Je me souviens des cravates d’un autre temps, je me souviens des nœuds.
Je me souviens des premiers laçages et de mes maladresses avec ces étranges ficelles.
Je me souviens de ce vieux jean gris acheté sur le marché et qui déplaisait à ma fille.
Je me souviens du déclic du container et du nœud du sac-poubelle, quand je l’ai jeté avec une vieille paire de baskets ;
Je me souviens de son maillot de bains avec des fleurs blanches. La lumière du couchant était douce, le ressac nous chantait le bonheur de l’avenir. Le petit bruit du velcros que l’on détache du col pour se dégager la gorge. Le froissement des draps et de nos respirations régulières, alors qu’un œil s’éveille dans la nuit. Le long zip de la parka qui se referme. Un vêtement ça parle, mais toujours à voix basse.
Gérard
Je me souviens que le t-shirt ressemblait à un T.
Je me souviens que les body ressemblaient à un corps.
Je me souviens que les « strings» ressemblaient à des cordes.
Je me souviens que les « tops » donnaient le départ d’une aventure.
Je me souviens que les bermudas faisaient rêver.
Je me souviens que j’ignorais d’où venait le mot trench-coat.
Je me souviens que je disais « sweetshirt » comme pour un bonbon.
Je me souviens des nuisettes en nylon.
Je me souviens des combinaisons qui se mettaient en vrille sous les vêtements.
Je me souviens des bas qui tenaient tous seuls.
Je me souviens des incontournables jupons en dentelle de Calais.
Je me souviens des cerceaux métalliques sous les jupons.
Je me souviens des motifs géométriques des robes de Courrèges.
Je me souviens des complets aux trois pièces.
Je me souviens des tennis Stan Smith en cuir épais.
Je me souviens du bout pointu des chaussettes tricotées à la main.
Je me souviens que les pattes d’ef trempaient dans la boue quand il pleuvait.
Je me souviens des pulls en laine Anny Blatt tricotées aux aiguilles n°1.
Je me souviens des gilets tissés qui sentaient le mouton.
Je me souviens de ma première polaire lourde et inusable.
Je me souviens des bikinis en vichy rouge et blanc.
Je me souviens des pantalons de ski terminés par une patte à glisser sous le pied.
Je me souviens des mouchoirs de Cholet grands comme des serviettes de table qui faisaient gonfler nos poches
Sabine
Six fois six, cycle écriture de nouvelles 2021/2022
 D’octobre 2021 à mars 2022 ils étaient six à tisser chacun(e) six histoires autour d’une photographie en multipliant les points de vue : c’était le projet de ce cycle d’écriture de nouvelles.
D’octobre 2021 à mars 2022 ils étaient six à tisser chacun(e) six histoires autour d’une photographie en multipliant les points de vue : c’était le projet de ce cycle d’écriture de nouvelles.
Pour retrouver les textes réunis en un recueil, joindre le contact: 06 13 50 34 94.
Cycle écriture de nouvelles 2020/ 2021
Un drôle de combat
Il a cinquante-cinq ans, et restaure, seul, une bergerie dans la Vallée Etroite. Il choisit exclusivement des matériaux régionaux. Il dénonce le coût des transports. Il porte toujours un jean bleu foncé et un pull en jacquard couleur bordeaux. A vingt ans, il réside au hameau du Roubion, et décide de s’engager dans la protection de sa vallée. Il dérange par ses convictions, son esprit sans concessions. En 2010 il participe à la Marche Transalpine pour le respect de la biodiversité. Il aime le terrain, le combat, l’engagement. Il dénonce la hausse du prix des terrains, le tourisme. Il exaspère. Il a dix-huit ans quand il effectue son service militaire dans les chasseurs alpins. Il envisage sérieusement de s’engager dans l’armée mais son rapport complexe à l’autorité le fait renoncer au dernier moment. Il n’est pas grand mais son corps est modelé par des années de pratiques sportives en montagne. A trente ans, il survit à une coulée d’avalanche dans le massif des Ecrins. Il entre au mois de mai 1998 au Service Départemental d’Incendie et de Secours. On le dit mutique. Mais ses moues valent tous les discours. Quand il prend la direction du refuge des Trois Monts, qui appartient au réseau Oxygène +, il écrit à sa mère que sa vie est là... A cinquante-cinq ans, vêtu de son éternel jean bleu foncé, il décide de faire, à pied, le tour des villes et des villages de son département pour témoigner de ses années d’observation en montagne. Son combat pour la préservation des sites lui vaut beaucoup d’inimitiés. Il dénonce l’abattage des arbres, la corruption des élus. Le 22 mars, il est pris à parti par des motards éméchés, qui l’agressent à coup de casque. Le réchauffement climatique le hante. On ne lui connaît pas de famille, seulement des convictions. Cela lui jouera des tours. A l’aube de ses soixante ans, et malgré ses précédents échecs, il décide d’entamer une dernière action de sensibilisation auprès des élus de son département. Le soir il sera mort, il est beaucoup trop gênant.
Dominique Fouassier, juin 2021
Illustration Ed Fairburn
Elle ouvre les volets de la porte fenêtre qui donne sur le jardin. Il ne pleut pas. Les quelques rayons de soleil qui ne jouent plus avec les nuages réchauffent un peu l’intérieur de la maison. Sa robe de chambre est usée mais bien chaude. Elle va prendre le petit déjeuner à l’intérieur. Il fait encore un peu frais dehors et elle pourrait attraper du mal. Derrière le haut mur de clôture du jardin, un bruit de tracteur qui passe. Les tracteurs sont de plus en plus gros et vont de plus en plus vite. Le hameau est trop petit pour qu’ils mettent des ralentisseurs, et le maire soutient son électorat paysan. La serrure du lourd portail en fer de l’entrée principale est fermée à double tour. Il n’est plus ouvert tous les jours.
Elle met de l’eau de bouteille à chauffer sur le gaz, elle allume le four pour réchauffer le croissant. Et aussi le pain d’hier sur le grill. Ca lui laisse un peu de temps pour prendre des médicaments. Bon, ne pas se tromper, ne prendre que ceux prescrits pour ces dix jours et les habituels, les journaliers. Avec ce qu’elle a pris hier soir, elle a bien dormi. Le pain sur le grill commence à fumer. Il est encore noirci mais elle l’aime ainsi. Dehors, les oiseaux sautillent, ils attendent les quelques miettes qu’elle va leur donner après le petit déjeuner. Non, maintenant, car le petit rouge-gorge est là. Il faut lui donner tout de suite avant que les pigeons arrivent et le chassent. Avant, le chien courait après, mais il n’est plus là, son maître non-plus. Elle a tondu la pelouse hier avec satisfaction et elle aime sentir cette odeur d’herbe fraîchement coupée. Le cerisier du Japon a bien tenu l’hiver. Le romarin et le rosier se disputent le coin près de la porte fenêtre. Il faudra en replanter un des deux ailleurs. Peut-être près de la buanderie.
L’eau bout pour le thé vert. Le grand bol bleu bien rempli pour démarrer la journée. Elle sera comme les autres, à moins que le chauffagiste ait le temps de passer pour la chaudière. Noter sur le bloc note ce qu’il faudra lui demander. Il est serviable et il pourra peut-être changer l’ampoule du lustre de la salle à manger.
Sur la table, s’entassent les revues et les journaux. Peu de place pour accueillir des convives. D’ailleurs, il n’y a plus d’invités. C’est trop de soucis. Il faudrait tout nettoyer, essuyer tous les bibelots, les vases, les cendriers souvenirs, épousseter tous les meubles de la grand-mère, toute la poussière qui vient si vite surtout quand on allume la cheminée; et puis il faudrait leur faire à manger. Une tarte pour le quatre-heures, ça c’est possible, mais une amie à la fois, pas plus, en étant prévenue à l’avance. Et qui pourrait passer ? La voisine ? Elle est très gentille. Elle m’aide pour les courses. Elle a deux enfants en bas âge et est très occupée. Avant, je pouvais sortir, aller voir une expo avec Christine, mais elle a déménagé, j’ai des nouvelles par téléphone. A deux, c’est plus sympa. Maintenant, je ne connais plus personne que ça intéresse. Seule, ce n’est pas pareil.
Est-ce que j’ai pris ce médicament-là ? Oui, je l’ai posé sur les journaux. Tiens, je n’ai pas lu la revue reçue hier… Il y a tellement de choses à penser et à faire.
Dehors, ça s’assombrit, il risque de pleuvoir.
Gilbert Benony, le 19-03-2021
Dans le fouillis des herbes sèches, les bâtons dégagent un alignement de quelques pierres taillées, la rigole de granit est toujours jointive. Un beau travail que n’aurait pas renié le burin du sculpteur.
En regardant leur découverte, les deux frères perçoivent comme un cliquetis de chaîne au cou des vaches, un grognement de bête qui se couche, un froissement de paille, comme un remugle de fumier.
Il ne reste presque rien mais c’est sûr, l’étable était là.
Le but de leur périple était bien de retrouver ce vestige désert sur le haut plateau ardéchois.
Les genêts et les fougères envahissent l’espace en contre-bas. Le vent pousse des vagues dans la prairie jaunie entre les touffes végétales. On n’a plus fauché depuis longtemps.
Ici, les hivers ont été terribles, jusqu’à trente degrés au-dessous de zéro et la Burle qui soulève des montagnes de neige, bâtit en quelques heures des congères infranchissables. Un vent qui ne permet pas aux plus forts de rester droit, qui tue les égarés.
Ce soir, les grillons accomplissent leurs derniers rites et les frênes têtards ont encore leur feuillage au-dessus des chemins creux, des chemins qui ne résonnent plus du passage des charrettes.
Personne ne coupera plus les jeunes rameaux pour nourrir les bêtes à la fin de l’été. Une moisson dans les arbres plantés exprès le longs des chemins, qui préservait le foin d’un hiver qui allait durer sept mois.
Quelques murets de pierres sèches ont résisté aux sangliers. L’obstination des mains nues les avaient érigés. Assurer pendant les mois sans gel, la survie annuelle de toute la ferme. L’obsession de cultiver et faire provision avant la neige suivante. Les mauvaises années tuaient bêtes et gens.
Comme une grosse lèvre, les nuages venus du Sud recouvrent lentement la montagne. Ils entendent encore la vieille Célestine de leur enfance qui leur parlait français mais qui avait gardé les tournures de son patois natal. « Quand c’est Marin, les bêtes se serrent, elles coupent les clôtures ». Ils comprenaient « Quand le vent vient du Sud avec son brouillard, les vaches inquiètes s’agglutinent au coin des pâturages et les clôtures peuvent céder sous la poussée du troupeau ».
Si le vent ne tourne pas, il y aura de la pluie cette nuit.
Dans la lumière dorée du presque soir, tout est relief. Pendant ces quelques minutes de grâce, le moindre nuage de moucherons est une pensée magique.
Le taureau et ses vaches ruminent tranquillement regroupés comme par hasard dans le pâturage. Ici, les bêtes ne connaissent plus la main de l’homme, elles ne rentrent plus le soir pour la traite, elles ne sillonnent plus les chemins. Et les ronces envahissent. Sur quelques rares sentiers, les cisailles et les scies des associations de randonneurs remplacent les troupeaux qui faisaient du propre de tout ce qui dépassait.
Cette nuit, toutes ces cornes dormiront à la belle étoile.
Méfiez-vous de leur placidité bovine, même les loups qui sont revenus ne s’y frotteront pas.
Ils appuient les bâtons contre la voûte effondrée, les sacs glissent des épaules. Ils déplient la carte d’état-major et le vieux cadastre napoléonien. Ils vérifient leurs repères, les deux ruines, le chemin, les courbes de niveau, reviennent aux cartes. Aucun doute, c’est bien ici.
En fouillant le lieu, ils exhument un clou mangé par la rouille, un clou de charpente forgé, une lauze ébréchée avec son trou de montage. Des reliques qui avaient peut-être connu la main de Victor.
Victor était donc né ici, il y a près de deux siècles, leur ancêtre.
A peine emmailloté, bien protégé sous la grosse veste de son père, le nouveau-né avait survécu aux quatre heures de marche dans la neige pour être baptisé le matin de Noël mil’ huit cent cinquante-six. C’était l’aîné.
Vingt ans après, le jeune-homme robuste avait quitté la ferme et ses onze frères et sœurs pour aller s’embaucher dans un village à douze heures de marche. Un nouveau puits de mine avait ouvert dans les Cévennes.
Au grand dam des maîtres du charbon, il remontait chaque année à la saison, le père commençait à vieillir.
L’été de ses vingt-huit ans, il était revenu avec Marie et leurs trois enfants.
Leur dernier né, Clovis, était mort pendant la moisson. Il avait quatre mois.
Cette nuit,Victor sera avec eux, la pipe au creux de sa main calleuse. Ils fumeront en silence en regardant le feu.
Tous siècles confondus, ils s’allongeront dans l’herbe sèche, le nez dans la nuit sans lune, ils finiront par fermer les yeux.
Une étoile filante écorchera l’au-delà.
Yves Delord
Marseille, 19 février 2021
Echauffement
On les emploie comme on respire ces expressions toutes faites, clichés familiers... avant d'en faire un texte " mise en bouche":
Ça sent l’arnaque ! L’homme est trop sympathique, ses propositions sont trop alléchantes. Je ne crois pas à cette procédure si rapide sur son site Internet. Mais il m’a dit qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien, quelques clics ne coûtent rien, on peut de toutes manières aller voir sur l’écran ; il ne faut pas en faire un fromage, une simple consultation, c’est tout !
Assis devant l’ordinateur, on entend voler les mouches dans cette pièce. Pour accentuer le silence, j’ai même enfoncé dans mes oreilles deux boules Quiès et j’ai allumé.
Mais ma bécane, c’est un canard boiteux. Il faut attendre la connexion au réseau et subir quelques messages imprévus. Pour jeter de l’huile sur le feu, une alerte au piratage s’affiche sur l’écran.
Cela fait près de deux ou trois minutes que j’attends. Je vais battre le fer pendant qu’il est chaud. Je clique. L’étrange lucarne reste noire. Comme un cheveu sur la soupe, mon téléphone se met à sonner. Je l’entends à peine. J’attrape l’appareil, un numéro inconnu s’affiche. Le temps de regarder, l’appel est interrompu.
Finalement, je n’en suis pas mécontent. Si le type set correct, il m’aura laissé un message. Je vais attendre un petit peu, me garder une poire pour la soif.
De toute façon, j’attends toujours cette fichue connexion. Enfin, quelque chose apparaît. C’est le dernier courrier que j’avais rédigé. Pourquoi ne s’était-il pas fermé ? Je le sauvegarde et reviens à la page d’accueil. On n’a pas beaucoup avancé.
Je clique à nouveau sur l’icône Google. Un petit cercle bleu se met à tourner lentement. J’ai le temps de consulter ma messagerie téléphonique. Je suis sûr que c’est encore ce type qui vient me jeter de l’huile sur le feu : « Il n’y a pas de mal à se faire du bien, quelques clics ne coûtent rien… ». C’est vraiment la fin des haricots !
Gérard
Hors champ
Hors champ...
Hors champ: C'était le thème de cette semaine de rentrée, dans les Alpes de haute Provence, du 7 au 11 septembre 2021. Hors champ sensible, au plus près de l'actualité parfois:
On dirait un champignon atomique, comme à Hiroshima. La photo publiée dans le journal semble être une image d’archives. En regardant de plus près on entrevoit la cote. Oui, c’est bien Beyrouth, là, sous ses yeux. Toujours en première page, d’autres photos, plus petites. Elles montrent en détails les ravages de l’explosion : le silo amputé, les façades soufflées, les immeubles effondrés, l’amoncellement des décombres, le vide provoqué par le souffle, des corps de victimes. La photo à la Une parait irréelle, démesurée par rapport à la taille du pays.
Hors champ, au téléphone, le récit des amis disent le silence des images. Jamileh, qui habite à 70 km, a entendu un sifflement avant l’explosion ; elle a pensé à un bombardement par les voisins du sud, comme avant. A 10 km au dessus de capitale, Vera a senti son immeuble trembler ; elle a d’abord cru à une explosion due à une collision entre camions. Boutros lui, a vu toutes vitres alentour s’effondrer. A Achrafieh même, le magasin de Tony a été pulvérisé, les employés étaient rentrés chez eux un quart d’heure auparavant.
De retour à Marseille, Joumana parle, sa voix est lasse, triste. Elle raconte ce qu’elle n’a pas réussi à exprimer à distance. Son arrivée à Beyrouth quelques heures après l’explosion, l’aéroport en partie éventré, les nouvelles de sa famille, sa cousine décédée, son cousin gravement brulé, seul survivant d’une dizaine de copains qui travaillaient ensemble sur le port. C’était le 4 août 2020.
Lili
Amour confiné
Nausée naissante. J’ai déjà la boule au ventre quand je me présente devant l’entrée de l’édifice, improvisée pour répondre aux contraintes sanitaires conjoncturelles. Deux portes coulissent. Une odeur d’alcool me saisit au nez et aux tripes. Une femme m’attend derrière. Gantée, coiffée, masquée, ensevelie. De bleu. De vert peut-être ?
J’ai envie de vomir. Je bafouille. Oui, je viens pour un malade. Oui, je sais que l’accès est interdit. Je viens seulement déposer son sac de vêtements propres. Et puis ses chaussons. Il n’avait pas besoin de chaussons jusqu’alors. En réa, on n’a pas besoin de chaussons. Et puis ses mots croisés. Il ne les fera peut-être jamais ces mots croisés. Il n’a pas la force. Mais ma mère les a glissés comme elle aurait pu glisser une lettre d’amour. Et puis un crayon à papier et une gomme. Non, non, chez nous on ne fait pas les mots croisés au stylo car on n’aime pas les ratures, ça fait sale. Mes yeux s’humidifient. Et puis les serviettes de toi- lette. Elles sentent la lavande de synthèse et sont rêches car maman les repasse pour que ça ne jure pas dans l’armoire. Et puis un échantillon de son eau de toilette. Pas le flacon ! S’il venait à repartir en réa ? Tu imagines, le travail des infirmières ? Sur- tout en ce moment. Pas facile en ce moment pour les infirmières ! Je souris. Il ne voulait pas de veste supplémentaire. Il ne l’a pas dit, bien sûr, il ne peut plus parler. Pourtant, je devine entre les vestes de pyjama amidonnées sa veste noire. On n’a jamais assez de lettres d’amour…
Madame ? Madame ? L’infirmière me sort de ma torpeur. J’ai vraiment envie de vomir. C’est l’odeur peut-être ? Cette odeur acre et tiède des hôpitaux. Quel service ? Quel étage, s’il vous plaît ? Bien… Votre nom de famille ? Signez-là. Frottez vos mains à l’alcool d’abord. Parfait, signez-là. Merci. Euh… je viens juste déposer ce sac vous savez ? C’est pour mon père ! J’ai l’attestation de déplacement nécessaire durant le confinement. Ah oui, je vous l’ai déjà dit. Vous me faites confiance ? C’est gentil parce que le gendarme tout à l’heure n’a pas été commode. Mes yeux rouges et ma gueule de souffrance… ça n’a pas suf- fi. Des explications, des justifications, des plaidoiries. L’attestation d’hospitalisation. Les lèvres et le cœur serrés, envie de ruer dans les brancards : vous croyez vraiment que je peux inventer ça ? Mon père qui s’étiole loin de nous, qui n’a pas la force de ré- pondre à nos messages désespérés ?
Madame ? Madame ? Vous avez deux sacs ? C’est bien cela ? Oui. Deux sacs de courses rutilants comme neufs parce que les valises, c’est pas pratique pour chercher dedans a dit maman. C’est bon, nous joignons le service. Un infirmier viendra cher- cher les affaires.
Ah ? c’est tout, je peux y aller ? Alors pourquoi m’attardé-je ? Le message est pourtant clair : «C’est bon, vous pouvez y aller . Il est là, au-dessus de ma tête, étendu dans le lit de la chambre 403 et je n’ai pas le droit de le voir ? Le verdict est tombé. Vous pouvez y aller . Mesdames et messieurs les jurés, je vous jure que je ne m’attarderai pas ! Des sanglots et des cris réprimés meu- rent dans ma gorge et m’étranglent. Chienne de vie ! Mes oreilles bourdonnent, ma tête tourne. Cette envie de vomir qui ne me quitte pas. Plus un mot. J’ai chaud. Je sue. Ma nuque picote. Ma tête est dans un étau de raison qui tente de comprimer le chagrin et la colère qui remplissent mon crâne. Ça dégouline de tous les côtés. Dans une grimace informe qui contient mal les muscles de mes mâchoires, je finis par vomir dans une voix rauque « C’est difficile, vous savez ».
Et oui, elle sait l’infirmière. Le confinement, c’est dur, et c’est pas fini.
Christelle
Confinés, hommage
Blouses blanches et cernes noirs
Sueurs aigres de l’effroi et odeurs âcres de désinfectant
Sirènes hurlantes et quintes en écho infini
Une main gantée sur l’épaule qui apaise
Une tasse de café tendue qui réconforte
Des rires hystériques qui défoulent
Les pleurs qu’on ne lâche qu’en rentrant chez soi
Jour après jour le courage d’y retourner
Le devoir, l’engagement, l’héroïsme
Dans la vraie vie ne sont pas glamour.
Les héros primordiaux montent au front au lever du jour
Pas en limousine mais en camionnette
Pas sur les stades ou les écrans ou sur scène,
mais sur les flots, dans les champs, devant leur pétrin, sur un chantier...
Ils sont récompensés par quelques pièces
Et non par de mirobolantes oboles
Ils restent inconnus de leurs bénéficiaires
Mais toujours là, indispensables et dévoués.
Sans eux et leur savoir-faire, que deviendrions-nous ?
Les vrais héros sont minuscules, invisibles et essentiels.
Elisabeth
Au hasard, des instructions pour...
... manger un hamburger
Espacer votre dernier rendez-vous chez le dentiste et le passage au Mac d’environ une semaine. Pas moins. Le jour J, évitez de porter une chemise blanche ou tout autre vêtement auquel vous tenez. Un vieux tee-shirt plutôt sombre devrait faire l’affaire. En rentrant dans le fast food, scrutez la salle de restauration et choisissez une table où vos coudes et bras se sentiront à l’aise. Si vous pouvez vous mettre face à un miroir, ce n’est que mieux car pour le big mac, quelques exercices d’échauf - fement de la mâchoire s’imposent : face au miroir, faites des O et des A en ouvrant la bouche aussi grand que vous le pouvez et terminez par la lettre I. Vous sentirez peu à peu la chaleur monter dans votre bouche. Cessez l’exercice avant la douleur (il est préférable de se réserver de la force musculaire).
Seconde étape : levez le hamburger à portée de votre regard et, de vos doigts habiles, faites-lui faire délicatement un tour sur lui-même. Le but est d’extraire simultané - ment, par petits coups de la mâchoire tout ingrédient débordant du sandwich. Pressez ensuite les deux tranches de pain entre vos doigts, doucement, pour que progres - sivement du liquide ou toute autre matière organique s’échappe de son étau de pain. Renouvelez l’opération (si vous vous sentez à l’abri des regards, vous pouvez vous aider de votre langue, toujours tout en délicatesse).
Pour les moins affamés, un troisième tour de hamburger serait l’idéal. Troisième étape : si vous avez suivi les consignes une et deux, cette étape devrait bien se dérouler. Elle consiste à lever le hamburger au niveau de votre bouche cette fois. Refaites un O, un A et deux I avec vos lèvres puis, sans marquer d’arrêt, faites un grand A en même temps que vous pencherez légèrement votre buste en avant pour atteindre le hamburger. Refermez votre bouche sur ce dernier sans hésiter (pensez à l’orque lorsqu’il croque une otarie). Le geste doit être sec et rapide. Si une partie du fourrage s’est échappé à l’arrière, c’est que vos dents n’étaient pas suffisamment incisives. Dans ce cas, ramassez à l’aide de vos doigts tout débris de viande, légumes ou autres aliments que vous pourrez replacer dans le sandwich, si vous souhaitez vous exercer. Sinon, regardez à gauche puis à droite et, si personne ne vous regarde, enfour - nez dans votre bouche au plus vite la matière que vous venez de récupérer. Il est bien évidemment préférable de se munir au départ d’au moins deux serviettes en papier.
Pour progresser dans l’art de manger un hamburger, nous préconisons des exercices faciaux tous les matins, tels qu’ils sont décrits en phase deux. Les vocalises peuvent aussi vous aider ainsi que croquer dans une pomme deux à trois fois par semaine (pensez à la puissance du geste, sec et rapide). Et maintenant, à vos exercices.
Laurence
A quoi tu penses?
Par hasard... c'était le titre d'une exposition à la Vieille charité, à Marseille, et l'occasion d'une séquence sur le thème, le 7 décembre 2019: Au menu : cadavres exquis et un texte écrit à partir de mots, phrases, piochés dans les livres mis à disposition et dans les cadavres exquis de début de séance.
Un texte support : celui de Nicolas Tardy sur son rapport au hasard dans son écriture.
Quelques cadavres exquis ( à prendre pour ce qu'ils sont...):
Le sapin insignifiant dévorera la montagne noire.
Le hasard décoré crève l'alliance joyeuse.
La fête sommaire rendra les bougies innocentes.
Moins "académique" : Qu'est-ce qu'un éléphant ? Une chanson douce.
Comment vois-tu ton avenir ? Cela se voit à l'oeil nu.
Qu'est-ce que l'envie de toi ? Une sortie de route autorisée.
Ecrit à partir de la contrainte du jour :
Qui a dit que le hasard faisait bien les choses ? Je venais de la quitter devant le café du coin où nous nous étions donné rendez-vous. Je l'y avais rencontrée quinze jours plus tôt. Elle portait une robe aux couleurs pastel, aux motifs évanescents. Un tableau de peinture abstraite...
-Comment vois-tu ton avenir ? m'avait-elle lancé en s'asseyant en face de moi, une tasse de café fumant à la main.
-Devant moi, avais-je été tenté de répondre.
Mais cette fille, c'était de la poésie sur pied, une chanson douce, un territoire vierge. C'est une chose qui peut faire rire, mais si j'étais Dieu, Eve je l'aurais moulée à son image. Alors j'éludai. Nous venions de nous accorder sur la destination de notre première escapade: pour elle
ce serait la Montagne noire, loin des sapins insignifiants et des bougies innocentes. Je m'inquiétais de ce que tu en penserais, avait-elle dit, ravie.
Elle rêvait d'alliance joyeuse, de maison blanche et de chemins où nous marcherions pieds-nus dans l'herbe fraîche. Moi de sortie de route autorisée et de nuit merveilleuse sans lendemain. Le temps qui passe ne change rien à l'affaire : se ferment les histoires de mes amours comme des livres qui glissent derrière la porte du temps qui passe.
Josianne
La part des anges
Le 6 juillet 2019, Domaine le Capellan, atelier sous les pins Photographie de Philippe Haumont, La part des anges, 1982
La part des anges
Instant
Comme volé
Donné pour éternité
D'un Kairos fugace volatil
Instant à saisir temps pour rien
Oublié le vent de la nuit
Ma sœur cette femme au front clair
Comme sortie d'une fête tranquille
Fêtes des vivants à l'ombre de nos morts
Belle d'une beauté paisible
Et libre et lumineuse
Lueur sans artifice
Sans attente
Josianne, juillet 2019
C'est l'histoire...
C’est l’histoire de deux verres
De deux vers pas trop longs
Deux verres qui m’attendaient sur le bord de la table
Deux vers vides, vides de sens que je gommais rageusement
Du cristal ? Non, transparents, je n’ai rien à dire et j’enrage
Boire dans ces verres, dans les deux à la fois, champagne-alexandrins, alexandrins- champagne
Rien ne rime et j’attends patiemment qu’il arrive qui partagera dans un rire les bulles de ma belle bouteille.
Sabine
Slamer l'éphémère...
ÉPHÉMÈRE
Ce n’est pas au sommaire
Juste dans l’atmosphère
Crise de nerfs
Fantôme en colère
Cœur grand ouvert
Déclenche la guerre
Destin trop sévère
Réfute les règles d’hier
Contemple tes galères
Au lendemain, espère
Un réveil moins amer
Le monde à l’envers
Eliminer le père
Sans épouser la mère
Ou le contraire
Ne plus se taire
Ne plus avoir à faire
Vivre libre sur terre
Parmi tes sœurs et frères
La joie de l’éphémère
Elisabeth
Frileusement...
Frileusement, un amandier en fleurs
Encore un peu de patience...
Vacances blanches
Routes engivrées au petit matin blafard
Invitation au réveil
Entre d'eux
Retour des bavardages sur les branches nues
De la fenêtre, l'amandier en fleurs se dresse, solitaire, frileux, dans l'air transparent. Encore un peu de patience... Les premiers signes émergent doucement, premiers signes d'une vigueur renouvelée. Mais c'est encore le temps des vacances blanches, des montagnes enneigées où se pressent de minuscules silhouettes noires, glissant sur leurs flancs majestueux. J'aime le silence des routes engivrées dans le petit matin blafard. Bientôt la douce chaleur du soleil caressera les feuilles engourdies, comme une invitation au réveil. C'est comme un temps suspendu. On dirait que l'hiver ne finit pas d'en finir, et pourtant, il est déjà derrière. Encore un peu de patience, l'entre deux demande du temps avant d'entendre le retour des bavardages dans les branches nues.
Caroline
Logorallye
Etre au monde. Rester debout, l’œil grand ouvert
Au moins un instant, face au soleil.
Avant qu’il ne décline.
Une fois encore, voir et toucher ses petits seins.
Le grand frisson pour certains
Le début de la fin pour d’autres.
Ton allure, quand tu marches juste devant
Et que je peine à te suivre
Sans courir
Nous n’irons plus au bois
Il n’y en a plus
Juste du papier, des papiers
Sauf pour les sans… ceux dont personne ne veut
Pas plus au crépuscule qu’à l’aube
Bientôt ce sera l’été
La chaleur adoucira- t-elle ton inquiétude ?
Tu dis que la nature te réconforte
Va donc te promener sur les cimes
Prendre un peu de hauteur et respirer
C’est tout
Et de nouveau le voyage.
Loin du pays de la mélancolie dont tu connais pourtant
Certains remèdes.
Je partirai, vois-tu…
Révélation, rêver l’action
Et ce mot imprononçable : « Nabukodi… »
Le répéter cinquante fois, comme une punition
Ou un exercice de diction
Temps de chiens ! Tiens donc…
Si on se faisait une tisane ?
Un sachet d’humilité à la sauge ou au romarin.
Qu’en dis-tu ? Dis, poupée de cire…
Tu dis non
Tant pis.
Je boirai seule. Rituel sensoriel en solo.
De toute façon je ne t’aime plus
En cette minute précise de mars, je déclare que
Voici venue la première minute du reste de ma vie.
Djamila
Odeurs de mon pays
Riedisheim
Je ne sais pas si je me sens vraiment appartenir à une région, mais quand j’interroge les souvenirs liés à mes perceptions olfactives, c’est toujours la maison et le jardin de mes grands parents à Riedisheim qui reviennent.
Odeur confinée des meubles et du parquet régulièrement cirés et frictionnés. Odeur envahissante de la soupe de légumes qui mijote dès le matin même en été. Odeur des tartines du gros pain fraîchement coupé.
Odeur du journal que mon grand-père plie, déplie et replie. A peine la porte passée c’est l’émanation forte, confuse et chaude du grenier qui est là.
Puis c’est le craquement des marches en descendant qui libère un parfum subtil.
En bas la grande et lourde porte s’ouvre sur le jardin, et là embrasement, fouillis des senteurs et dilatation des narines !
En avant du tableau des odeurs quelques moutons derrière la clôture. A chaque déplacement ils envoient leur présence en rubans aléatoires que mon nez animal flaire avec délice. Il n’y a qu’ici que je retrouve cette empreinte animale si particulière.
Puis c’est la putréfaction des fruits tombés et abîmés qui se révèle, quetsches, mirabelles et pommes. Plus délicate la senteur de l’herbe foulée, fraîchement mouillée ou sèche et que je respire à pleins poumons dans mes déplacements vagabonds.
Qu’est ce qui a fait que dans ce jardin, toujours aussi présent, j’ai le souvenir d’avoir ouvert mes sens ? J’y ai bu chaque son, chaque image, chaque sensation, chaque odeur et me suis laissé envahir par les humeurs de la vie dans ce qu’elle a de plus réconfortant.
Françoise, janvier 2019
,
Odeurs de ma ville
Non je ne me souviens plus des odeurs de l’Afrique, du Liban, celles dont je me souviens émanent de ce lieu où je vis maintenant. L’odeur de quelques parcs, ilots de verdure, ponctués d’espèces dignes de jardins botaniques L’odeur de la mer, des embruns, sur une plage déserte, dans le petit matin. L’odeur de la pêche sur la criée du port, poissons frétillants, crustacés ruisselants, avant que ne se vident les étals débordants. L’odeur des épices, leur mélange de couleurs qui expriment leurs puissants arômes venus de rives lointaines. Et les herbes de Provence fruitées et apaisantes qui imprègnent nos plats du Sud proche, en deçà de la mer. Et les odeurs humaines, amalgame de sueurs fortes et parfois repoussantes. Odeur d’urine des hommes, des hommes de la rue, SDF, mal logés. Odeurs de poubelles ouvertes, de containers éventrés. Relents entêtants dans la chaleur de l’été. Autant de signifiants d’une ville appauvrie. Et l’odeur des grenades, grenades lacrymogènes quand la ville se révolte contre son mal à vivre. Restent enfin les collines et les crêtes des calanques, qui sertissent la ville, leurs odeurs de broussailles, de garrigue, de pins ou même d’oliviers selon où l’on chemine.
Souvenirs et empreintes des senteurs de Marseille, ma ville, mon pays, où s’entremêle le monde.
Lili, janvier 2019
Le bruit que fait le monde
Ecoute… Ecoute l’haleine de la terre qui hante ses soupirs. Je voudrais être là sans rien avoir à dire. Sans avoir à sourire. Être là, simple balancement dans les exhalaisons d’humus. Ecoute cette soie qui glisse et qui lape son ventre. Ecoute les oscillations végétales dans le vide du silence, dans le néant léger. Ecoute le souffle des cerises sures tombées sur le sentier, l’expiration putride des amanites pourries, une gifle au sourire, une insulte à la nuit. Ecoute… je voudrais être là sans rien avoir à dire. Yves, Octobre 2018
Des formes et des sons
Soirées entières
Banquette étroite
Deux chambres, pâle
Son visage, ses mains
Contre la paroi
Tu l’entends sortir
Pour atteindre sa fenêtre
Ou son lit, ou ses armoires
La bassine de plastique rose
Il ne reçoit jamais personne
Il est un homme d’habitudes
Il quitte sa chambre même le dimanche
Il offre aux badauds des grands boulevards
Sa valise ouverte, bouton et bague
Fonctionnement inconnu, primitif
Rien n’empêche, dans un but que tu ignores
Qu’il n’ouvre et ne ferme comme la goutte d’eau
Les bruits de la rue, que tu interprètes
Avec sa valise, peignes, briquets
Il vit condamné à tousser
S’écoule, la vie qui demeure
Tu fais si peu de bruit
Mais qui ne cesse jamais
Attentif il a peur
Rester silencieux
Un bruit minuscule
Sympathie secondaire
Ou au contraire
Frappant du pouce
Un coup, deux coups...
Laurence
Univers sonores
Paul VERLAINE (1844-1896)
(Recueil : La bonne chanson)
Le bruit des cabarets, la fange du trottoir,
Les platanes déchus s’effeuillant dans l’air noir,
L’omnibus, ouragan de ferraille et de boues,
Qui grince, mal assis entre ses quatre roues,
Et roule ses yeux verts et rouges lentement,
Les ouvriers allant au club, tout en fumant
Leur brûle-gueule au nez des agents de police,
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui glisse,
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l’égout,
Voilà ma route - avec le paradis au bout.
Les bruits: ils sont blancs, roses ou aériens... Bruits de fond, résiduels, aériens... ils balisent nos univers sonores.

La chanson d'automne de Claudine Il y a le vent Il y a les feuilles Il y a le vent feulant à tes oreilles Il y a les feuilles dansant comme des abeilles. Il y a le vent Il y a les feuilles Et le vent te vole une chanson Et les feuilles jonchent ton gazon. Il y a le vent Il y a les feuilles Et le vent porte l'appel du petit chien Et les feuilles crissent des mots de rien. Il y a le vent Il y a les feuilles Et le vent hurle de furieuses sirènes Et les feuilles chutent des cimes lointaines. Il y a le vent Il y a les feuilles Et le vent clame le stade et ses joies Et les feuilles crient écrasées sous tes pas. Il y a le vent Il y a les feuilles Et le vent bouscule et le caddie roule Et les feuilles accueillent les pigeons qui roucoulent. Il y a le vent Il y a les feuilles Il y a le vent qui te pousse à rentrer Il y a les feuilles t'appelant à rester Il y a le vent Il y a les feuilles Et le vent t'appelle vers un coin de ciel bleu Et les feuilles se replient en te disant adieu. A quatre mains, Claudine et Noëlle
Ce que l'on emporte avec soi...
Man Ray Apprentissages Cahier posé, oreiller blanc, feuillets sur la taie, froissée Cahier-livre perdu autour des mille écrits À la va-vite Lire le livre, le livre-cahier cassé Une lame vibre sur la peau mouillée Pique l’épée Le cri des biques aux longs cils, une larme coule, tire l’encre des mots violets. Tâche. Une tâche sur taie, oreiller blanc. Des jours autour de la taie, fils tirés. Les doigts effilés tirent les fils, taie d’oreiller Au petit jour, cuisse lisse, cuisse libre des draps froissés. Libre livre, cassé. Lire les feuillets posés sur l’oreiller, blanc. Feuillets tâchés, cuisse lisse posée sur l’oreiller blanc Petit jour, le cri des biques de l’île, gicle le lait, frais. Pique l’épée, baiser à côté, une larme-lave, petite île Une goutte de sang sur l’oreiller blanc Yves
Septembre 2018, pour une escale corse
Ici, ailleurs, partout,
Ici, le temps semble arrêté
Dans le silence des montagnes.
L’ailleurs est déjà loin, Dans la fureur et dans le bruit.
Partout, autour de moi Des collines et des cimes,
Des bourdonnements d’insectes, Ici, le rire des amis.
Ici, j’oublie l’ailleurs Dans cette île magique
Où partout la beauté, l’harmonie, l’amitié
Apportent à mon âme et mon cœur Un souffle de liberté.
Laïla
Ici, mer et montagne s’imbriquent
Ici, nature et silence se fondent
Ici, le tumulte intérieur s’apaise
Ailleurs, le bruit envahit la ville
Ailleurs, le béton étouffe le rivage
Ailleurs, la foule bouscule le rêveur
Partout, des regards s’échangent
Partout, des sourires réchauffent
Partout des mains se tendent
Lili
Ici, ailleurs, partout, Corsica
Ici, la lumière du levant, la caresse Du silence
Ici, le parfum du figuier.
Ce matin, présidés par l’horloge,
Réunis, sur le bois de la table,
On nous dit,
Ailleurs, les cris de la ville. Au de là de la mer apaisée
Et des vents Qui se taisent aujourd’hui
Partout, le monde court.
Ici, les nuits sont ouvertes
Les essaims Nous ont prêté la maison
Le coq a remplacé la mécanique.
Gérard
Musée Fech, à Ajaccio...
-
Inventaire à la Prévert Un musée corse Une cour carrée, un beau palais, Une caisse d’entrée et un vigile Des vénitiens, des florentins et un Titien Et des cadres dorés… Une fête vénitienne, une déesse endormie Une vierge tropicale La tentation d’une chouette Et des cadres dorés…
Un long couloir, Des natures mortes, Un perroquet, deux vaches, trois moutons, Une licorne et des poissons, Des fleurs, des fruits, une pastèque, Et des cadres dorés…Des Sainte Famille Avec ou sans le petit Jean-Baptiste Mais toujours le zizi de l’enfant Jésus Des Christ en Croix Des Descente de Croix Et des cadres dorés… Saint Jérôme, Saint Antoine, Saint François Et tous les saints du paradis Des déesses, une sorcière, des femmes lascives Et des cadres dorés… Des hommes sévères lisant la Bible Homère jouant du violon Un enfant grattant un oud Des adolescents au regard brillant Et des cadres dorés… Toute la famille Napoléon Au rez-de-chaussée, En sculpture, en peinture, Dans des cadres dorés. Et des petits cadres dorés, Et des moyens cadres dorés, Et de grands cadres dorés Partout, partout des cadres dorés… Fab
Une idée de l'îléité
Villa Carli, à Cannelle, Martine Boudes, aquarelle
Ma terre
Cette terre qui m’a élue
Pas la tienne
J’en fais mon miel de ses ciels
Piquetés d’étoiles
De ses forêts irréelles
De ses rochers posés sur le sable rosé
De ses talus sculptés comme des topiaires
De ses aubes pâles et ses crépuscules tonitruants
Cette terre qui est mienne
Ah ! Nager dans ses eaux limpides
Me reposer sur ses plages abritées
M’allonger sur des feuilles de palmier nattées
Et boire du thé
Sur cette terre
Terre sans ville, terre-île.
Claudine
Atelier nomade... Voyage voyage
Redortiers, 9 et 10 juin 2018
Si jamais vous passez par chez moi […] je vous montrerai un spectacle étrange : une région de collines et de plateaux où dorment sept à huit petits villages absolument déserts. L’herbe pousse dans les ruelles, les toitures s’enfoncent, les orties fourrent les fenêtres basses. Un grand silence les enferme […] . Lettre de Giono à Lucien Jacques, 1922.
Le Contadour, dans les actuelles Alpes de Haute Provence. L'atelier d'écriture ce mois de juin, c'était là, non loin du Moulin, tout près de la ferme des Graves, où vécut Jean Giono.
Apprentissages
Quatre chevals. Non, chevaux ! D’accord, « 4 chevaux », mais en fait on l’appelait « 4 pattes ».
« 4 chevaux, 4 portes, 444 mille francs. » C’était la « réclame » de Renault pour donner envie aux français d’acheter la « 4CH ». Celle-ci n’était que l’autre voiture de la tribu. Elle eut été bien trop petite pour avaler les quatre garçons, et le père, et la mère, et les bagages, et le reste.
Imagine un peu, verte.
Verte comme une olive avec une petit coffre ridicule sous le capot avant. Un coffre déjà à moitié rempli du passage des roues, du cric et de la manivelle, de la roue de secours, et de la batterie. Pour la batterie je ne suis plus certain. Tu sais, elles sont loin les années 50 et ma bonne mémoire aussi.
Avec ou sans batterie, dans le peu de place qui restait dans le coffre, le père avait mis une trousse à outils, des chiffons graisseux que la mère refusait de laver, une peau de chamois toute cartonnée et deux gourdes en alu cabossées.
Les gourdes cabossées, c’était de l’eau pour le radiateur, « au cas où », dans les grandes montées.
Avec la « quatre pattes » vert olive, il n’avait jamais eu besoin de sa réserve d’eau, mais le père était prudent. Il faut dire qu’il avait commencé sa carrière automobilistique avec un des premiers modèles de voiture démocratisée, une Celta 4 d’occasion, avec des freins à câbles devant et derrière. Pas vraiment efficaces, les freins et un radiateur qui se mettait à écumer dès qu’il entendait parler de montée.
Depuis la Celta 4, le père avait gardé l’habitude d’anticiper ses freinages et de mettre dans le coffre des gourdes pleines d’eau… qu’il ne fallait surtout pas boire. C’était de la vieille eau et c’était pour le radiateur.
Bref, le moteur, lui, était à l’arrière sous un capot arrondi, vertical, comme un bouclier-écu, pointe vers le bas, aéré de petites lames inclinées.
Mais oui, ça me revient, la batterie était là, à l’arrière, à côté du moteur. Un moteur tout simple et pas très gros. Il y avait de la place sur les côtés, on pouvait y mettre les mains, faire l’entretien soi-même et même des réparations pour les plus dégourdis.
Essaye un peu de faire la même chose maintenant, avec ta belle voiture…
Donc, devant, le coffre à bagage, bagage sans « s », au singulier. Entre le cric et les gourdes cabossées, on ne pouvait glisser qu’un seul sac de voyage.
Le père se servait de la 4CH vert olive pour son travail et pour nous rejoindre en fin de semaine lorsque nous étions en vacances avec la mère, une sorte de voiture de secours et moi, je mettais mes petites mains sur le volant immense, bien assis sur les genoux du père.
Plus tard, je passais les vitesses, complétement couché sur le côté pour atteindre le levier vertical, tout en bas, entre les deux sièges avant. Dans cette position, je ne voyais plus la route, mais le père était là, qui tenait le volant. Moi je passais les vitesse et j’étais le roi du pétrole.
Á douze ans mes jambes se sont allongées, mes pieds atteignaient enfin les pédales de la 4 pattes vert olive. On gardait les voitures bien plus longtemps qu’aujourd’hui, on attendait qu’elles meurent dans nos bras, avant d’en acheter une autre. Elles nous voyaient grandir.
Le père m’avait initié au secret du démarrage en côte. Un savant mélange d’embrayage, de « champignon » et de frein à main. Le père appelait « champignon », l’accélérateur. Un champignon qu’il fallait « écraser » quand on voulait doubler. Quand j’étais petit, les camions étaient très gros, ils roulaient très lentement et crachaient noir-épais-qui-pue. Il fallait les doubler
Á seize ans, nuitamment, j’empruntais la 4CH vert olive. Première escapade avec mon amoureuse, sous la lune camarguaise.
Le père n’a jamais rien su de ce premier acte délictueux, ni de ma découverte cette nuit-là d’un autre usage de la voiture…
Cinquante ans plus tard, je me plais à imaginer le père faire semblant de ne pas m’avoir entendu partir avec la 4CH vert olive et s’endormir avec son petit sourire en m’entendant rentrer, bien plus tard.
Le père avec son petit sourire, qui n’aurait jamais rien dit à la mère.
Yves, le 10 juin 2018
Les personnages
" Un jour ils sont là. Un jour, sans aucun souci de l'heure. On ne sait pas d'où ils viennent, ni pourquoi ni comment ils sont entrés. Ils entrent toujours ainsi, à l'improviste et par effraction. Et cela sans faire de bruit, sans dégâts apparents. [...] Ils: les personnages". ( Sylvie Germain, Les personnages)
Alors on s'est lancés! Avec François Bon et sur les traces de Matt Olbren, nous sommes allés à leur rencontre, leur inventant des petits matins, des travers, des secrets, des ombres et des lumières,"nourris de nos rêves et de nos pensées"... Et c'est une autre histoire... mars 2018
Année 2018
BONNE ANNEE!
Les derniers jours des Escales méditerranéennes au musée Regards de Provence, à Marseille, et la proposition de recenser Ceux qui..., à la manière de Prévert, inspirés par la très belle exposition au Regards...
Ceux qui aux mains calleuses Ceux qui portent et qui soufflent Ceux qui poussent Ceux qui tractent Ceux qui se courbent et qui souffrent Ceux aux charges si lourdes Ceux qui courbent l’échine Ceux en haillons Ceux qui roulent les tonneaux Ceux qui chargent les bateaux Ceux qui vendent Ceux qui marchandent Ceux qui achètent Ceux qui s’enrichissent Ceux qui aboient des ordres Ceux qui papotent Ceux qui bavassent Ceux qui bourgeoisement Ceux qui promènent en rubans Ceux qui rêvassent Ceux qui lisent Ceux qui chapeau de paille Ceux qui flemmassent en organdi bleu Ceux qui peignent Ceux qui se chauffent au soleil Ceux qui naviguent de guerre Ceux qui voguent à la voile blanche Ceux qui braquassent en pointu, Tulututu ! chapeau pointu ! Ceux qui folâtrent Ceux qui hainent Ceux qui aiment sans donner Ceux qui donnent sans aimer Ceux qui enfantent Ceux qui trop vieux Ceux qui très jeunes Ceux qui à la peau flétrie Ceux qui bedonnants Ceux qui déambulent sur les quais du vieux port en ce jour de juillet 1898 à 11h47 Frédérique
Atelier nomade, octobre 2017
Quand St Jurs, dans les Alpes de haute Provence, accueillait nos ateliers en balade,où en êtions-nous de "se souvenir"... « Des vies, mais telles que la mémoire les invente, que notre imagination les recrée, qu’une passion les anime. »
Nos oublis, les paysages sonores d'hier et d'aujourd'hui... et les listes de Sei Shönagon, autant de prétextes à l'autofiction, les 28 et 29 octobre 2017, pour un atelier nomade.
J’ai oublié. Pourrais-je dire, j’ai tellement oublié que je ne peux plus rien écrire ? J’ai oublié : eh oui ! Il n’y a plus rien dans ma tête, aux emplacements de la mémoire. J’ai oublié même le néant d’où je viens. J’ai oublié certainement le jour de ma naissance, mais j’ai oublié aussi mon appareil photo. Il paraît que j’en avais fait de si bonnes au mois d’avril. J’ai oublié paraît-il mon rendez-vous et l’itinéraire. C’est ainsi que vivent les poètes. A force d’écrire, ils oublient le reste. J’ai oublié aussi, omis, négligé, perdu, les années révolues, mais aussi ce que j’ai lu hier soir, et peut-être ce que l’étrange lucarne nous a servi aussi. J’ai oublié d’écrire à Monsieur Troussepète ou de faire un message à Madame Truquemuche, pour lui rappeler qu’il faut penser à : arroser les plantes, préparer un gratin, nettoyer les vitres, à penser en somme. Elle n’oubliera pas elle. Elle sait où elle est. J’ai oublié beaucoup de choses. Il suffisait d’y penser, mais penser est ce si facile ? Ils ont oublié tant de choses, c’est tout un inventaire. Gérard
.
Printemps des poètes 2017, couleur Afrique(s)
Quelques bouquins sur l'Afrique, prêtés, empruntés, de belles photos, paysages, hommes, femmes, enfants... Choisir une photo, un document qui vous inspire, et partir en roue libre le temps d'un récit aux couleurs du continent africain. Narration à partir du dessin « les margouillats à la broche » / Carnet d’Afrique, JANO, Les Humanoïdes Associés La nuit tombe Et, déjà, le margouillat pompe. La nuit tombe d’un coup Et le margouillat allonge le cou. Il y a toujours un margouillat qui pompe sur les murs d’Afrique. Le margouillat, c’est l’aérosol, la bombe Anti-moustiques d’Afrique. La nuit tombe, Les bruits montent, s’élèvent. Des bruits plein de couleurs, Plein d’odeurs et de saveurs, Des bruits qui vous enveloppent. Les feux s’embrasent dans les concessions. Les femmes s’affairent, Les hommes discutent, Le Sage est sage. Les zémidjans, pétaradant, n’ont pas cessé d’aller, lumière vacillante ; Quand ils ont de la lumière… Le zémidjan, la mobylette bleue façon made in china, Le transport en commun, Treizième mois des policiers racketeurs. Il faut bien vivre… Et pendant ce temps-là, le margouillat pompe encore. Jean- Claude Sokey Edorh Ma maison dominait la sienne, une maison en tôle, entourée de bric-à-brac. Je m’approche doucement, discrètement, curieuse : le voir, l’entendre, ses enfants et des pots de peinture partout. C’était calme. Une femme, sa femme, préparait le repas. C’est ce que je me dis. Les enfants jouaient et un homme, 40 ans, la peau noire brillante, me regardait. Grand, beau et, surtout, ancré dans le sol, épaules souples. Rien dans son regard de méfiant, d’interrogateur. Entrez ! Je suis entrée sans crainte. Je suis peintre et poète, voulez-vous visiter mon atelier ? Oui, merci. Des tableaux, qui ont accrochés mon regard. Je ne pouvais plus regarder ailleurs. Il peignait sur de la toile et le fond était un mélange de latérite. Silence. Il parle : « La latérite est ma terre ». C’est leur terre. Mon regard se porte sur un tableau et, avant ma question, il me dit : « Ce sont les pas des femmes qui dansent, qui chantent, qui pleurent. Leurs pas sont gravés dans la latérite. La base de mes tableaux, c’est la latérite sur toile ». Un autre tableau, des jumeaux derrière des barreaux : la prison. Si vous privez une famille de ses enfants, surtout si ce sont des jumeaux, vous la conduisez à la mort. … Je peux vous les acheter ? Marie Femmes d'Afrique Les deux jeunes femmes rient au bord du fleuve. Leurs enfants jouent dans l’eau, s’éclaboussent, garçons d’un côté, filles de l’autre. Les deux jeunes femmes ne sont pas sœurs mais co-épouses d’un homme, Tchéba, qui aujourd’hui, se marie pour la troisième fois. La petite est jolie, c’est sûr. Mais si jeune. 14 ans à peine. Pourra-t-elle supporter les corvées, les travaux des champs ? Et ses hanches sont bien étroites pour accoucher, dans neuf mois, n’importe où, avec elles deux comme sages-femmes. Elles rient. Ce sera si facile de lui rendre la vie dure. Jusqu’à ce jour ennemies, elles se sont liguées spontanément contre l’intruse. Après tout, dit la première épouse, elle ne sera que la troisième. On le lui fera payer. Nos enfants nous aideront à la malmener. Elles ont pourtant revêtu leurs plus beaux boubous, et feront la fête, comme si de rien n’était. Le dimanche à Bamako, c’est le jour du mariage. Mais lundi, elles vérifieront que la gamine, excisée comme elles, était bien vierge. Et a autant souffert qu’elles. Elles rient. Fab
Atelier nomade pour un état des lieux, novembre 2016
Ecrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.
Georges Perec
Espèces d'espaces
Deux jours dans le Luberon: l'occasion d'un atelier pour écrire sur nos propres traces...
La trace d'un trajet familier
Avignon- Nyons : 60 kilomètres La tête de la greffière
L’hiver, petit matin, garage
Alexis ouvre la porte de la voiture, jette son sac à dos et se vautre sur le siège avant.
Je m’installe au volant. On a à peine bu un café. Une douche en vitesse. Pas sûre même d’être coiffée.
« De toute façon, toi, tu te coiffes jamais. Y’a même pas de brosse dans cette baraque. »
Sur la route de Violès, une demi heure plus tard.
Apparaissent les Dentelles de Montmirail. Belle lumière. Le jour s’est levé. Mon fils somnole sous sa capuche, j’écoute la Matinale de France inter.
La semaine commence.
Voix intérieure
« Il a souri à nouveau ce week-end. Au fait depuis combien de temps ne souriait- il plus ? Il est vrai que je ne suis pas toujours souriante et que ma propre mère s’en désole quand elle se lance dans le tri des photos. »
7 heures 30
La belle voix de Bashung entre deux nouvelles du monde tel qu’il va. Chanson extraite de son album le plus récent. Je ne sais pas encore que ce sera le dernier.
Traversée du paysage intérieur, le profil de mon fils avec un léger mouvement d’avant en arrière.
Il dort. La route est belle.
Sortie de Vaison la Romaine. Ça monte et ça descend.
On a fait tant de trajets en voiture, tous les deux .
Co- pilote efficace, même à six ans. Ne se trompait jamais sur les itinéraires. Comme quoi, les chiens font parfois des chats, mon sens de l’orientation est plus que vacillant.
Plus tard encore.
C’est l’arrivée sur Nyons. Après avoir traversé une place, la petite montée pour aller au lycée. Alex est réveillé et, depuis cinq minutes, ne cesse de me parler.
Nous sommes un peu en avance. Je me gare pas trop près du lycée.
Encore quelques minutes ensemble.
Il me manque déjà, est tout entier dans ses projets copains, les matchs à venir, le contrôle de maths.
Il est volubile, vif.
« Allez je file, mam. A vendredi »
Il s’élance hors de la voiture. Petit signe sans se retourner.
Des années plus tard, je pleurerai comme une fontaine à chaque vision du film de Xavier Dolan « Mummy ». Il y a une scène où la mère qui parle à son fils adolescent, en voiture, lui dit à peu près ceci :
« Quand tu étais tout petit, j’avais le sentiment que tu m’aimais encore peut-être plus que je ne t’aimais. Et puis, en grandissant, les choses s’inversent. C’est moi qui t’aime de plus en plus et c’est toi qui t’éloignes. »
Je vais boire un café. Double, crème, sans sucre.
L’enfance s’éloigne.
Je reprends la route.
Djamila
Autrefois
Enfance
On a attendu, on a fait traîner, on a cherché des stratagèmes mais au bout du compte, il a bien fallu céder devant les grognements de notre père. La nuit était encore douce et la maison fraîche. Pourquoi rentrer ? Pourquoi quitter le paradis pour la fadeur de la ville ? La voiture est là, bête docile avec son dos rond et l’odeur de ses sièges qui ne sent plus vraiment le neuf. Le coffre est déjà plein, il ne reste plus que les personnages qui entrent en traînant dans l’habitacle.
Ma tête dodeline. Je repense aux moments passés, les amis, les copines, les parties de foot, les balades, les jeux, les rires. Dans la voiture, mes parents parlent mais déjà je ne les entends plus. Que font mon frère et ma sœur, j’ai oublié. Je me souviens du paysage qui défile inexorablement : les champs, les vaches, les bosquets au loin et les souvenirs de vacances qui se bousculent, le rire de Sylvie. Pas de larmes vraiment mais la sensation d’une plénitude infinie qui nourrira les jours sombres et gris de l’automne en ville.
Quand la campagne finit-elle par capituler ? A quel moment le monde de l’enfance est-il dévoré par la mécanique broyeuse du monde des grands ?
Quand le passage à niveau se baisse et que les autos s’entassent comme des insectes serviles, ce n’est plus déjà la campagne et pas encore la ville mais il faut payer un droit de passage, une rançon.
C’est à cet instant que la boîte à souvenirs se ferme et qu’une autre s’ouvre. Celle-ci sent le ferment brumeux du gris des murs. Elle sent l’odeur de l’essence et des rues humides et grasses. Après, le rythme s’accélère, les immeubles jettent un regard sévère sur la 403 qui se hâte. Puis une longue ligne droite et le parking. Je tente de m’accrocher à des lambeaux de rêve. Rester encore un peu. Garder au chaud mes souvenirs. Il faut pourtant sortir, porter quelques sacs.
Les réverbères, ces géants anonymes, ne clignent pas des yeux. Ils sont immobiles et rassurants.
Ils t’ouvrent la ville et tu cherches en vain à leur en vouloir. Ils sont restés fidèles pendant que tu caracolais dans ton havre de verdure. Ils t’ont attendu, muets, pour t’accueillir, pour que tu ne te perdes pas. Il fait nuit mais il fait clair. Tu sais déjà que tes souvenirs d’enfance s’effaceront et que même ces cerbères dociles finiront par mourir. Alors tu avances. Tu sais sans savoir. La suite, tu la connais par cœur ; la lourde porte de l’allée, l’odeur de granit, la dureté de la pierre, les coquillages incrustés dans les marches, le monde minéral domestiqué que tu foules de ton pas d’enfant. Et cette montée vers le refuge, cette ascension inexorable. Tu ne peux pas y échapper sinon en comptant : un, deux, trois, quatre…Il n’y a pas d’issues, on ne peut pas redescendre et cette montée vertigineuse te donne le tournis. Tu vois tes aïeux un à un disparaître et bientôt c’est le palier, la porte massive et vernissée, une porte ancienne, travaillée, artisanale.
Roland
Quelques coups d'oeil dans le rétroviseur...
J'ai en moi deux images d'un passé lointain reconstruit, qui ne s'annulent pas mais se superposent.
Je me souviens. J'ai 7 ans. Rencognee au coin d'une maison grise, pour moi Gap sera toujours grise, je pleure. Je ne pleure pas, je sanglote. Maman va partir, Maman s'en va. Elle nous laisse. Elle me laisse. Il fait froid, je grelotte dans cet angle venteux. Bientôt, ce sera Noël. Sans eux, qui vivent au chaud, en Afrique. Cette petite fille, dans le lointain de ma mémoire, agitée de larmes et de froid, c'est moi. Ça y est, elle monte en voiture. Elle pleure. Un dernier geste de la main à travers la vitre. Elle n'est plus là, ni ses rires, ni ses baisers, ni ses chansons. A nouveau, je suis abandonnée.
Je me souviens. J'ai 10 ans. C'est Noël. Le premier avec nos parents. Parce que nous sommes plus grandes et moins fragiles, ils nous ont ramenées en Afrique. Au matin, la salle à manger est fermée. La porte s'ouvre. Une pièce illuminée. Tout au fond, un immense filao travesti en sapin de Noël, et dans tout l'espace, des paquets, des paquets, des paquets. Tout ce dont des enfants peuvent rêver, même la boîte à couture si désirée depuis longtemps. Au fond de ma mémoire, deux fillettes émerveillées, aux rires enchantés, et les visages heureux de nos parents.
Ces images si antinomiques, je les conserve soigneusement. Elles se répondent comme dans un miroir inversé. Avec elles, sur elles j'ai construit ma vie : il y a un temps pour tout, un temps pour le désespoir et un temps pour l'espoir, un temps pour le malheur et un temps pour le bonheur.
Demain est un autre jour, tout ira mieux après.
Fab
L'interro
Je me suis levé tôt pour réviser. Il y aura une interro d’maths c’est sûr ! Et peut -être un contrôle de géo !
D’après ce qu’a dit le prof’ la semaine dernière, ça va arriver. Je ne sais pas encore tous les noms des républiques soviétiques, faut qu’je révise, l’Ouzbékistan, le Truckistan, non, c’n’est pas bon ça !
Bon, tant pis, j’ai plus le temps de réviser, faut y' aller.
Hé ! un chien qui court vers moi, il a l’air agressif. Je cours avec difficulté vers le lycée, j’n’arrive pas à courir. Si ! Je passe le portail, il ne me suit plus.
Le prof’ de maths, distribue les copies, dix problèmes ! Faut gérer, je comprends rien, j’ai chaud, ah ! Si ! une question facile, c’est noté sur 20, j’aurai déjà deux points, ça suffit pas !
Faut s’relire, non j’attaque les autres. Je comprends rien.
Qu’est- ce qui se passe, les autres écrivent, pas moi. J’n’arrive pas à comprendre l’énoncé. Deux sur vingt ça n’va pas l’faire !
BRRRRRR BRRRRRRR
Le réveil !
En sueur.
Ouf ! C’était encore ce cauchemar d’école !
Ben
La boîte à boutons
Par endroits effacés, les motifs patinés de la boite à boutons. La boîte à boutons de ma mère ?Peut-être avant, celle de ma grand-mère, il y a des transmissions. Des transmissions qui ne disent pas leur nom. Il faut savoir, être dans leurs secrets.
Mes secrets sont ailleurs.
La boîte à boutons de ma mère. Le couvercle est retourné sur la grosse table devant la fenêtre. La pile de vêtements à repriser, boutons perdus à remplacer. Je sens l’odeur chaude des bûches qui s’enflamment. Cette année pas de chêne, que de l’amandier. Beaucoup ont gelé les années précédentes. La porte du poêle en fonte qui claque. Le loquet ajusté d’un petit coup de tisonnier. Mon père reprend sa pipe et son journal.
Glissements de boutons. Le doigt cherche dans la boite, fait glisser les boutons. Le bruit du doigt dans la boîte, doucement, pour ne pas déranger le désordre secret des boutons. Quand on prend la boite à boutons, avant de l’ouvrir, il y a toujours l’espoir de le trouver posé, juste sur le dessus, celui qui va aller, sans le chercher. Peut-être celui qui était tombé. Le bouton qu’une main aurait ramassé et hop dans la boite à boutons pour le jour où. Pour le jour où il faudrait le trouver. Moment magique, on le trouverait.
Les boutons juste écartés, il est peut-être dessous, juste en dessous. Glissements de boutons. Les bords des boutons sont arrondis, comme usés, c’est lisse, ça glisse dans la boîte à boutons. Les boutons glissent les uns sur les autres, petits bruits glissés un peu amplifiés par la boîte métallique. Au bruit, elle est bien pleine.
Mais la magie des boutons, c’est quand même de la magie, ça ne marche pas toujours, il faut y croire. Le doigt n’y a pas cru. Le bouton n’est pas là.
Peut-être plus au fond. Le doigt plonge dans la boîte. Faire remonter le bouton caché, le doigt en crochet.
Ouille ! Le doigt dans la bouche. La pulpe de l’index pressée contre le pouce, une perle rouge au bout du doigt. La bouche suce la goutte salée. L’aiguille oubliée, l’aiguille en embuscade au milieu des boutons.
On sait bien qu’elle est peut-être là, mais on n’y croit pas, pas cette fois. Enfin, le doigt n’y croyait pas ou bien il avait oublié. Oublié la dernière fois où il s’était piqué dans la même boîte. Le doigt était sûr de l’avoir rangée. Il devait y en avoir une autre ou bien elle est revenue…
La boite est renversée sur la table. Ça finit toujours comme ça. Une cascade de boutons, un ruissellement et puis le silence. La main à plat, du bout des doigts. Glissement de boutons. Tiens, elle est là. Une vraie petite aiguille, encore enfilée. Une aiguille à bouton. J’imagine ma grande sœur. Un bouton à la va-vite, assise sur une fesse, juste avant de sortir. Pas le temps de retourner à la boîte à couture. La main pressée a posé l’aiguille dans la boîte à boutons, juste au-dessus des boutons. Au moins elle ne la chercherait pas la prochaine fois. Quelqu’un aura déplacé la boîte, un peu secoué. L’aiguille se sera cachée. Au milieu des boutons. Elle attendait un doigt.
Du bout des doigts, ma mère cherche le bouton. Celui-là ou un autre, celui qui ira, qui ira à peu près. Parce qu’un bouton de braguette c’est pas grave, il est caché par la patte. Il suffit qu’elle soit bien fermée la braguette, que ça ne baille pas en s’asseyant.
Sur les genoux de ma mère mon pantalon attend son bouton. Pantalon gris rayé, en flanelle doublée. Le pantalon du grand-père, retaillé. Mon premier pantalon long.
Honte de mes culottes courtes. Le dernier à venir au collège habillé comme ça. Comme les minots.
J’étais fier de mon premier pantalon long. Je ne voulais plus le quitter. Enfin, je ne voulais plus retourner au collège avec mes culottes courtes. Le jour où ma mère l’a lavé. Je n’avais que celui-là avec les jambes longues. Alors le matin je l’ai décroché de la corde à linge et je l’ai enfilé, encore mouillé, raide de givre.
Il était épais le pantalon du grand père, retaillé. Je l’ai gardé mouillé toute la journée. Le soir quand je suis rentré il était sec, sauf à la ceinture et aux revers.
- « Pourquoi tu as mis ce pantalon ce matin, il n’était pas mouillé ? Tu en avais d’autres. »
- « Non Maman, il était sec. »
Alors vous comprenez pour la boîte à boutons ? C’était important qu’elle remplace le bouton de la braguette. Elle pouvait bien mettre le premier qui lui viendrait mais je ne voulais pas remettre mes culottes courtes.
- « Maman, ne t’embête pas, n’importe quel bouton… enfin, pas rose quand même.»
Yves
Rentrée 2016/2017, ce qu'il nous reste d'un été
Eté 2016
7 juillet 2016. Les enfants vont venir se baigner. Il fait très beau, très chaud. Le pays ne se remet pas de l'attentat de Nice, les politiques jouent la surenchère démagogique, les journalistes traquent les familles de victimes, les rescapés. Les musulmans se dédouanent en affirmant le rejet des extrémistes, en dénombrant leurs morts. La télé, la radio, les journaux ne parlent, ne montrent ad nauseam que ça. Relégués aux oubliettes de l'information, les attentats en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Afrqiue, des milliers de morts, les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe, se noyant par centaines, les millions de déplacés déstabilisant des continents entiers. Les Français n'ont d'yeux que pour les 87 morts de Nice. Leur univers nombriliste se referme sur eux. Des portières de voitures claquent, voici toute ma famille réunie autour d'un barbecue. A table on ne parle pas du drame, parce qu'il y a les petits. Joseph sort de l'eau, s'assied à côté de moi : "Teta, pourquoi il y a des gens méchants qui font ça ?". Dans ses yeux, il y a de la peur, le besoin de comprendre, le sérieux de la situation l'affecte malgré l'omerta des adultes devant lui. Comment expliquer l'horreur, la folie à un enfant de sept ans, hyperprotégé, qu'on fait vivre dans un monde de bisounours. Ma tentative de réponse maladroite, très maladroite, ne semble pas le rassurer. Heureusement sa soeur et sa cousine l'appellent pour se baigner encore. Il se lève et court vers elles, joyeux, délivré de l'univers des grands.
Fabienne
Dans les gorges oubliées, le véhicule roule. Les parois sombres plongent dans le torrent qui brasse des eaux grises. L’été est là, pourtant : sur les pentes les mélèzes sont verts et une tache bleue, comme perdue, s’étale au-dessus de ma tête. Et le soleil enfin, au bout du défilé, l’espace retrouvé, la respiration qui repart à son rythme et le village, enfoui pendant des décennies dans les brumes de ma mémoire, qui réapparaît. Eté 2016, je ne reconnais pas les chemins empruntés avant. Le Chien m’accompagne. Il court, il sent, il tient la piste. Il est chez lui. Il s’arrête et m’attend. Dans son regard profond, je vois se rejoindre le passé et le présent. Il va et je le suis, dans ce Haut Lieu du tourisme d'où sont bannies les voitures. Sur les coteaux abrupts où l’on faisait les foins, se dressent des chalets. Le chien, en avant-garde, s’est jeté et s’ébroue dans la fontaine en bois qui fait toujours couler son eau. Il fait chaud. Des touristes s’arrêtent pour goûter la fraîcheur offerte et fixer, sur la pellicule, le balcon fleuri qui les a séduits. Je vais avec mon compagnon canin à la recherche d’une maison, d’un nom… Boutiques de souvenirs, sculpteurs sur bois… Mais où est donc passée la petite épicerie du village ? « Mais où sont passées les neiges d’antan ?... » La neige, il y en a toujours, car sur l’alpage on a planté des poteaux de remontepente. Honneur au ski… Mon guide tourne autour de moi. Que veut-il ? Dans le gouffre insondable de ses prunelles, je lis comme une attente. Je regarde et je vois : l’église… un repère de la vie antérieure, de l’immuabilité dans un monde qui bouge et qui voit le paysan devenir hôtelier, l’épicerie, en son temps fort utile, vend, désormais, le rêve des artisans du lieu. On peut restaurer, embellir, mais on ne peut et on ne doit pas tout détruire. L’Église, le Temple en contrebas, et les anciennes maisons se doivent d’exister, contre-point essentiel au néo-folklore paysan de pacotille. Le Chien et moi avons suivi la ruelle. A la sortie du village, la Nature a repris ses droits : les mélèzes se sont multipliés et dispensent sous leurs rameaux agités une fraîcheur agréable, à quelques mètres seulement, une marmotte se dresse. « Mon bon Chien, dis-moi : Pourra-t-on profiter, encore longtemps, des bienfaits des hommes et des beautés du monde ? »
Josette
Nice, juillet 2016
La chaleur écrase la ville depuis le lever du jour. Chaleur de plomb, étouffante comme la violence de l’attentat de Nice ce 14 juillet 2016. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc, à l’arrêt du tram. A t-il appris la nouvelle ? A-t-il entendu parler les passants ? Il ne bouge pas, il ne frémit pas, perdu dans un ailleurs inconnu de tous, inconnu de lui peut-être. Depuis le matin, je le regarde, je l’observe, je l’épie même, depuis ma fenêtre, pour oublier la nouvelle. Je l’ai apprise hier à minuit, la nouvelle. Au retour de la fête pour l’anniversaire de Samira j’ai allumé la télévision, machinalement. A cet instant j’ai souhaité être sourde et aveugle. J’ai éteint la télévision aussitôt après. J’étais transie d’horreur. Cette folie engendrée par l’oppression, l’humiliation, cette folie attisée par les discours de haine, cette folie meurtrière ravive mon sentiment d’impuissance. J’enrage de constater l’inutilité de nos luttes antiracistes, l’échec de notre engagement militant, l’écrasement de notre idéal politique, des décennies plus tard. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc. Il semble ne pas voir les trams défiler, ni les voyageurs s’agglutiner aux portes ouvertes de la rame. Il semble ne pas entendre le vacarme qui l’entoure. La tombée du soir n’apporte aucune fraîcheur. Deux heures du matin, l’homme au regard bleu s’allonge sur le banc. Enfin, il s’endort.
Lili
Nice, juillet 2016
La chaleur écrase la ville depuis le lever du jour. Chaleur de plomb, étouffante comme la violence de l’attentat de Nice ce 14 juillet 2016. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc, à l’arrêt du tram. A t-il appris la nouvelle ? A-t-il entendu parler les passants ? Il ne bouge pas, il ne frémit pas, perdu dans un ailleurs inconnu de tous, inconnu de lui peut-être. Depuis le matin, je le regarde, je l’observe, je l’épie même, depuis ma fenêtre, pour oublier la nouvelle. Je l’ai apprise hier à minuit, la nouvelle. Au retour de la fête pour l’anniversaire de Samira j’ai allumé la télévision, machinalement. A cet instant j’ai souhaité être sourde et aveugle. J’ai éteint la télévision aussitôt après. J’étais transie d’horreur. Cette folie engendrée par l’oppression, l’humiliation, cette folie attisée par les discours de haine, cette folie meurtrière ravive mon sentiment d’impuissance. J’enrage de constater l’inutilité de nos luttes antiracistes, l’échec de notre engagement militant, l’écrasement de notre idéal politique, des décennies plus tard. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc. Il semble ne pas voir les trams défiler, ni les voyageurs s’agglutiner aux portes ouvertes de la rame. Il semble ne pas entendre le vacarme qui l’entoure. La tombée du soir n’apporte aucune fraîcheur. Deux heures du matin, l’homme au regard bleu s’allonge sur le banc. Enfin, il s’endort.
Lili
Mai 2016, écrire à Bages
Lettre à l'ange
Bages, le 28 mai 2016
Ange, mon ange,
Où te cachais-tu ?
Hier soir, sortie de cinéma, impossible de remettre la main sur mes clés de voiture. Retourné les poches intérieures de mon sac, trop grand. Fouillé ses fentes. Le grand cirque. Croisé les doigts, invoqué ma bonne étoile : pas plus d'ange gardien que de trousseau de clés.
Inutile de vilipender ma légendaire distraction, de revendiquer mon droit à la fantaisie, le contenu de mon sac répandu sur le trottoir, c'était juste bon à faire fuir les Sigisbée de tous poils. C'est un baragouineur de première qui est venu à mon secours. Pas le genre à vous faire croire au printemps au cœur de l'hiver, ni à vous faire grimper en montgolfière, mais le chenapan, « Mademoiselle, je suis sûr que je peux faire quelque chose pour vous », a-t-il dit, penché sur le fatras « jeté de sac », a tiré d'en dessous de mon porte-cartes, coincé entre mon porte-monnaie et mon paquet de cigarettes à moitié vide, le porte-clés, au bout duquel pendaient mes clés. « Ce que vous cherchiez » ? a-t-il interrogé, l'air à peine rigolard.
Le fatras a réintégré mon sac, définitivement trop grand, et vexée comme un psyllé, j'ai arraché des mains de l'homme, mon trousseau - il sentait la misère et des pieds- pris mon sac sous le bras, mes jambes à mon cou et retrouvé ma voiture dans le parking. Du premier coup. Ouf !
Merci mon ange !
Josianne
Bages, le 29 mai 2016
Chère inconnue,
Votre message découvert ce matin dans ma boite aux lettres me laisse rêveur. Lettre sans timbre déposée par une main discrètement parfumée.
Je ne vous connais pas mais votre histoire a fait courir mon imagination. Votre sourire en sortant du cinéma, le film vous a plu. Le sourire volé par la main qui s’énerve et qui ne trouve pas. Le rouge sur vos joues. Votre sac rageusement répandu sur le trottoir. Votre silhouette accroupie sous le réverbère. La fouille fébrile dans les plis du sac vide dérangeant quelques effluves de votre parfum. Votre inquiétude à l’approche de ses pas. Votre menton volontaire pointé vers lui pour lui montrer que vous n’avez pas peur et lui interdire de s’imaginer des choses. Votre cœur qui bat quand même beaucoup trop vite. Votre bouche pincée devant les clefs tendues, sa main qui ne tremble pas. Vos talons précipités vers le parking. Votre soupir en vous asseyant dans la voiture, il ne vous avait pas suivie. Avec la sécurité retrouvée, un soupçon de regret peut-être… de l’avoir si mal jugé ? Qui était-il vraiment ? Odeur de misère et de pieds ou un remugle de caniveau ?
Je comprends votre trouble qui vous a fait choisir ma boite aux lettres plutôt que celle de votre ange et qui vous a fait écrire machinalement au dos de l’enveloppe votre nom et adresse.
Je viendrai donc lundi à 19 heures, j’en aurai le cœur net. Votre ange serait-il une réalité ou une bouteille à la mer ?
Un ange à peine réel et solitaire qui pourrait bien être le vôtre.
Yves
Où il est question d'un p'tit bonhomme...
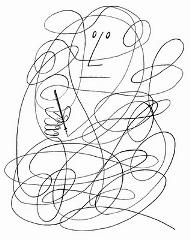 Je suis un âne
Je suis un âne
J’ai pensé que c’était dommage de ne pas en profiter mais le temps s’écoulait.
La chaise craquait, on voyait que la table avait bien vécu, un rayon de soleil sur le tapis iranien, le chat qui passait, un stylo, un cahier. Un cahier vide et ma tête. Ma tête pleine qui n’arrivait pas à associer ces mots, faire naître une idée, le début d’une histoire, une histoire qui ne serait pas venue de moi. Elle devait bien être quelque part cette histoire qui n’arrivait pas. Une histoire de temps, d’un autre temps, d’un temps perdu. Avec une belle fin, élégante.
Rien. Le vide. J’aurais mieux fait d’aller courir.
J’ai regardé sur mon épaule…
Pourtant les images se bousculaient. Un paquebot dans la nuit. Un contre-jour indiscret. Une chemise de nuit. Un atelier bruyant et sale. Un chahut d’ouvrières en blouse, visages maculés. Un chemin de douanier. Un pianiste dans le salon de première, le salon vide. Un phare dans la tempête. Une passagère égarée dans les coursives en chemise de nuit. Un piano droit. Une table qui en a vu. Un fauteuil de théâtre cassé. Un soutier noir hilare, torse luisant, une pelle à la main. Le pianiste en tenue de jazzman sifflotant dans la coursive. Des personnages arrivaient, ils s’en allaient, sans s’arrêter. D’autres restaient, commençaient leur histoire et puis plus rien. Paralysés. Muets. Plus aucune pensée. Inutiles.
J’ai regardé sur mon épaule… d’habitude il venait, là.
J’ai rassemblé mes jambes sous moi, toute mes forces, prononcé des formules magiques, cherché des exemples, convoqué les ancêtres, éteint et rallumé les lumières.
J’ai invité les pensées que j’aime, celles qui ne m’ont jamais laissé tomber. Evoqué mes fantasmes, des situations embarrassantes, mes rencontres étranges, pour qu’il vienne sur mon épaule, qu’il me raconte une histoire.
Rien, pas un bruit, pas une odeur. Les mots sont restés vides.
J’ai regardé sur mon épaule… Pourtant il ne m’avait jamais lâché… Enfin, jusqu’à ce matin.
J’ai bu un autre café, croqué une autre pomme.
J’ai ouvert toutes les portes, cherché le mouvement.
J’avais juste besoin d’un petit mouvement, un mouvement de rien du tout. Un souffle, un coup de vent, une robe, un chapeau, n’importe quoi, mais que ça vole.
Rien n’a bougé. Chapeau vissé et robe sage.
Je me suis dit que rien n’était irréversible, que j’allais me débrouiller sans lui. J’ai pris mon temps.
Du bout des doigts j’ai effleuré le cahier. Le stylo tournait entre mes doigts, lamentable. Je l’ai posé.
- « Mais où tu es petit bonhomme? »
J’ai regardé sur mon épaule… rien.
J’ai regardé mon autre épaule. Il était là, tranquille, même pas essoufflé.
- Je lui en voulais : « Tu es en retard petit bonhomme…
- « Ouais, » qu’il m’a dit, « Néanmoins il y a des choses qui se comprennent facilement. »
- Là, j’ai explosé : « Fais pas le malin ! Tu m’as laissé tomber… Pourquoi tu as fait ça ?»
Le petit bonhomme m’a souri, de toute sa gentillesse :
- « Tu crois que tu as écrit ça tout seul ? Tiens, il te manque le titre. Arrête de râler, prends ton stylo, écris. Tu y es ? Ecris ton titre : … Je suis / un âne. »
Yves
Centons
Une écriture en deux temps
Ecrire des centons à partir de sa propre production de figures de styles: anaphores, épiphores, anadiploses... excusez- nous du peu... Et puis découper. Coller. Ajouter. Sabrer. C'était un après-midi de mai 2016, à Marseille.
Ce jour-là il faisait beau. Le chat se léchait sur le divan.
Allons enfant, réveille-toi, il faut partir, la journée commence. Allons enfant, réveille-toi.
Le chat s'enroula paresseusement sur le divan.
Il faut partir, la journée sera longue. Longue comme un soleil d'été. Eté de ma vie. Printemps de la tienne.
Le chat s'endormit sur le divan. Ce jour-là on prépara le pique-nique. Ce jour-là, on partit gaiement et on marcha un moment.
Le chat rêvait sur le divan.
Alors il se mit à pleuvoir très fort et l'on revint trempés dormir près du chat sur le divan .
Fabienne
Déchaîné
Petite île oubliée. Oubliée et battue de mer et de marées, battue et rebattue de vagues fracassées. Petite île habitée, fracassée de tempêtes.
Ici tout est mer. Mer et sel, dans les moindres détails, les détails des détails.
La mer, le sel et les tempêtes.
Dans les terribles histoires de nuit à la veillée. Les terribles récifs, coques éventrées emportées par les vagues. Corps et choses jetés à la mer, emportés par les vagues. Rejetés par la mer, par les vagues de mer. Histoires de corps, de morts et de tempêtes, histoires à mourir, à mourir de peur.
Un court, un long, trois courts. Cinq éclats de phare dans l’explosion des vagues. Masse de pierres noires ruisselantes, masse noire, une tour éclairée, à la tête éclairée, à l’assaut de la nuit. Cinq éclats de phare fracassés de tempête pour protéger la vie.
La vie des hommes qui cherchent. Les hommes qui cherchent le bout du monde et qui se perdent ici. Se perdent au bout du monde. Les vagues et les récifs. Un monde de chaos, un chaos de remous, de remous et d’écume, de mer et de récifs. Un monde dans la nuit, terrible et irréel.
Un voilier démâté ramené par le vent. Vent de tempête. Le voilier fracassé aux récifs. Vagues de mer. Vague de sel. Dans les moindres détails, les détails des détails, tout est salé.
Les enfants sont salés.
Sur la côte battue des enfants grimaçants jettent des hommes, des hommes à la mer.
Masques d’enfant. Des enfants pour rire, pour faire semblant. Ils jettent leurs peurs. Leurs peurs à la mer. Ils jettent leur masque. Le masque de leurs peurs.
Ils mangent des glaces, des glaces salées, au caramel salé, salé au sel de mer. Des enfants à rire, des enfants à apprendre, pour apprendre à rire et à laisser faire, à faire lâcher. A lâcher les chaînes, les chaînes et les boulets. Des enfants pour rire.
Dans les moindres détails, les détails des détails, tout est salé. Mer et sel. Ile oubliée. Ile fiction sans réalité. Sans réalité. La réalité qui enchaine, des chaines et des boulets, qui les soude aux pieds. Réalité boulet aux pieds de liberté, de liberté d’écrire. D’écrire salé, d’écrire déchainé.
Yves
Monologue intérieur
Un début d'histoire à prendre ou à laisser.
Une invitation à jouer avec le thème proposé .
Et puis il y a des mots en vrac...
Enfin la cerise sur le gâteau, l'emploi du dialogue intérieur.
Les portes
Claque la porte… mais laquelle ? J'ai tiré les rideaux, face à la baie vitrée je regarde… Le ciel crépusculaire grisonne et assombrit les façades qui se dressent non loin. Il n'y a pas un souffle ; les acacias s'étalent, immobiles, et plus bas, les haies de troënes n'ont pas un frémissement. Tout est calme, figé… Ce mutisme m'agace, il est contraire à mon sentiment du moment. Je veux que les branches se tordent et que gémissent les troënes, que le sable fouetté du jeu de boules se soulève en mini-tornades. Oui, je veux claquer une porte. Tu m'écoutes mais je vois bien qu tu ne me comprends pas. J'enrage… La perplexité qui flotte dans tes yeux dément l'air sérieux que tu adoptes. Et tu ris en refermant la porte d'une chambre. La nuit est entrée dans la pièce où je joue le quitte ou double de ma vie. Je regarde la fin du ballet des chauves-souris qui, ponctuelles, raturent le soir. Arrête de clore cette pièce ; j'étouffe... Non tu ne comprends pas. Tu me dis que je suis compliquée, que mes actes sont contradictoires, voire incohérents. Vois-tu, je sais que c'est absurde, je souhaite t'expliquer mais en même temps je crains de te blesser par des mots qui reflètent mon désarroi. Aujourd'hui, je suis un peu lasse ; je n'arrive pas à repousser les battants de toutes ces portes qui, insensiblement, ont réduit mon espace. Un jour, crois-moi, avant que je ne sois engloutie par toutes ces ombres qui pénètrent ici, je claquerai la porte pour la vie, je serai libre, libre comme l'air.
Comme ce sera bon…
Josette
Ermite
Mais c’est quoi le bout du monde ? C’est où ?
Peut-être cet endroit que j’aimerais trouver, où j’aimerais rester. Un rêve, une aspiration, un compte à rebours, pour solde de tous mes comptes.
Il se dessine dans le brouillard, en haut de la vallée, tout là-haut. Dans le brouillard d’avant la nuit. En pierres sèches, on le dirait là depuis toujours… enfin presque. Parce qu’au début il n’y était pas, bien sûr. Et maintenant il est là et pas pour rien, pas par hasard. Quelqu’un en avait besoin. Quelqu’un qui venait d’ailleurs ou qui était de là mais qui voulait être ailleurs. Enfin, il l’a construit là, avec ses mains, avec patience, en pierres sèches. Pierres et bois. Il a pris son temps. Sans déranger, sans abîmer. On dirait qu’il a toujours été là. C’était sa place. Sa main est partout. Dans les chevilles de la charpente, dans l’assemblage des pierres sèches, au fond de l’abreuvoir en pierre taillé, sous le rocher. Il est fondu dans le brouillard. Je l’ai trouvé. La cheminée ne fume plus. Depuis longtemps. Abandonné par fin du compte ou par besoin d’aller plus loin. Et plus personne.
Pas un lieu pour disparaitre. Un lieu pour vivre. C’est pour ça qu’il fallait la source et le toit dans la pente et des murs en pierres sèches pour se protéger mais pas des bêtes, pas des gens, pas de la mort, juste pour se sentir protégé, la porte ouverte, jamais fermée. Et le jardin, clos de pierres, pas trop haut, pour le sentir protégé.
Combien ont vécu là ? Se sont succédés ? Seuls au bout du monde ? Une famille ? Des enfants peut-être, à faire grandir. Des enfants à faire pour vivre, à faire pour rire. Des enfants à protéger mais pas de tout. Pour les laisser partir, pour qu’ils puissent partir, quitter les pierres sèches et le toit de lauzes et la source. Partir.
Et moi je veux être dans ce bout du monde. Je vais y vivre seul. Quand plus personne n’aura besoin de moi, quand je serai prêt à vivre de la source et des pierres sèches sans avoir besoin de personne.
Pas pour me cacher, pas pour disparaitre, pas pour mourir, juste pour être au bout du monde et y rester et me trouver et me prouver que je peux continuer sans avoir besoin de m’appuyer. Et me nourrir de rien et du jardin et de rencontres et de passages. Des pas sur le sentier qui surprennent les pierres sèches. Pour une halte, une tombée de brouillard, un moment partagé, une fin de journée ou un début d’étoiles, sans brouillard, un feu allumé, une soupe à préparer, lentement épluchée, une marmite au feu. La soupe partagée, fumante, le cul sur le rocher. Une pomme coupée, partagée. Une nuit aux étoiles et la nuit qui finit.
Mais c’est quoi le bout du monde ?
Le bout, je le vois bien, de mieux en mieux, sans inquiétude.
Mais le monde, je ne sais pas trop. Mon monde. Le bout du monde. Et s’il était là, juste à côté de moi. Et pas si loin de toi. Un bout du monde à inventer. Chacun de son côté. Et pourquoi pas, à partager.
Yves
Ouvre la fenêtre, j'ai tellement chaud.
Mon corps brûle, ma tête va exploser, mon cœur bat à grands coups : calme-toi ma belle.
Ouvre la fenêtre, tu n'entends pas ce que je dis ? Est-ce que je parle seulement dans ma tête ? Ou bien, comme toujours, tu n'entends rien, tu ne comprends rien ?
J'ai besoin d'eau, il fait tellement chaud. Il faut qu'il m'aide à sortir de moi, à voir à nouveau l'infini des étoiles et la lune au-dessus des toits. J'aimais tellement cette heure de la nuit. Mais où es-tu ? Il faut qu'on parle. De lui, de nous. Savoir où on va, quoi !
Bof ! Si on ne le sait pas, c'est aussi bien, non ? Droit dans le mur ou droit dans la chambre, c'est tout droit quand même. Qui me parle ? J'entends des voix : « Réveillez-vous Madame, l'opération s'est bien passée. »
S'il-vous plaît, ouvrez la fenêtre, il fait tellement chaud. Merci.
Fabienne
A la volée
Une série de mots, à la volée et une phrase de départ.
La proposition : écrire un texte commençant par cette phrase et incluant tous les mots.
L'éveil
L’appartement sentait le graillon ; je les entendais parler dans la cuisine. Le ton était enthousiaste et joyeux mais la vilaine porte rose était fermée et j’étais bien trop loin dans le couloir. Aucun espoir de saisir la teneur de ce qui les réjouissait.
Ça ne me déplaisait pas finalement. Je n’ai pas fait un pas de plus. Je me laissais porter par les inflexions de ces voix chaudes si différentes l’une de l’autre.
Non, je ne regrettais rien. Je n’avais nul besoin de participer à cette conversation. Ces voix féminines inintelligibles résonnaient en moi et me donnaient à méditer.
Tiens, la méditation. C’était notre jolie prof de français qui nous avait parlé de ces pratiques et de leurs bienfaits étranges. Bien sûr on avait voulu essayer avec les copains mais je n’avais jamais pu démarrer de manière correcte dans ces exercices. Je n’avais connu que des déceptions sans pouvoir définir où se trouvait le point d’accès à cet état de conscience mystérieux. On avait fini par se lasser.
Et voilà que la simple musique de ces paroles de femmes qui ne m’étaient pas destinées me transportait sur des chemins inconnus. Je me sentais zen et prêt à connaitre l’au-delà de la réalité. Mon cerveau recevait toutes ces vibrations, mes pensées s’échappaient. Je voyais ces deux jeunes femmes sensuelles discuter joyeusement. J’entendais leurs éclats de rire dans le chemin. Je les voyais s’amuser, courir et tournoyer, les robes danser, se soulever. Quelques perles de transpiration, des coins de peau dévoilés et je percevais des effluves troublants.
Le printemps était chaud.
Je voyais leurs vêtements s’envoler au bord de l’étang comme des hirondelles. Je voyais deux beaux nénuphars épanouis. Je voyais les corps nus s’avancer dans l’eau, les paumes ouvertes, les éclaboussures au soleil jusqu’au feuilles des arbres, les rires sur leur bouches pleines.
Je sentais l’appel de l’amour, des effleurements. Je sentais l’extase s’approcher, tout en longueur. Des soupirs.
Et puis le méchant voile, marron et noir jeté sur de si belles choses. La porte de la cuisine s’est ouverte et la voix de mes tantes :
« Nicolas ? Tu es rentré ? Viens vite goûter et puis tu feras tes devoirs à coté de nous. »
Les nénuphars se sont refermés sur les senteurs musquées. La froide odeur de graillon était revenue… dommage.
Mais
La méditation
J’y reviendrai
Les nénuphars
Sans les devoirs
Sans le graillon.
Yves, avril 2016
Marron
L’appartement sentait le graillon ; je les ai entendus parler dans la cuisine. Je les croyais déjà partis. Mais, la vieille voiture de l'oncle n'ayant pu démarrer, ils avaient dû rebrousser chemin, à leur grand regret. Je les entendais soupirer, déçus de ne pouvoir participer à la course annuelle de l'association. Surtout Jean, mon père, qui avait manqué la victoire l'été dernier d'une demi-longueur de jambe pour finir deuxième à la course. Il désirait plus que jamais participer à la suivante, dans l'espoir de la gagner. Pour cela, il était prêt à tout, à s'entraîner la nuit s'il le faut. Mon père ne croyait pas en la destinée. Pour lui, c'était une croyance de fainéants : « J'ai perdu de quelques dixièmes de secondes. Ça s’étudie. Je ne crois pas en la malchance ». Aussi s'était-il mis en tête de se définir un mode d'entraînement adéquat pour optimiser ses capacités physiques. « Je veux gagner, j'y arriverai », répétait-il fréquemment.
Pendant plusieurs jours, je l'ai vu s'asseoir en tailleur au bord de l'étang de nénuphars, derrière l'immeuble. C'était l'été. La chaleur suffocante ne semblait pas le déranger. Je l'observais discrètement, ne voulant pas rompre son travail de méditation. Puis il avait la tête, a ouvert grand les yeux et s'est mis à sourire à je-ne-sais-quoi d'invisible devant lui. Intriguée, je me suis avancée. Mais il ne me voyait pas. On aurait dit qu'il souriait aux anges. Avait-il reçu un message des cieux ? Je n'osais pas bouger, de peur de le ramener trop brusquement à notre réalité. Au bout de quelques minutes, sorti de son état d'extase, il m'a demandé si j'étais là depuis longtemps. Pour ne pas l’inquiéter, je lui ai répondu que j'arrivais à l'instant. « Je crois que j'ai la solution pour l'année prochaine ». Puis il ne m'a plus rien dit. L'hiver suivant, je l'ai vu s'entraîner plus que jamais, par tous les temps. Le printemps venu, il n'a pas relâché le rythme, focalisé sur des entraînements rigoureux qui l’aveuglaient sur la beauté printanière.
C'était bien la première fois que je ne le voyais pas s'émerveiller de l'éclosion de la première rose du jardin. Notre couple d'hirondelles était revenu pour bâtir un nouveau nid d'amour qui accueillerait ses futurs petits. Mon père s'était coupé de cette sorte d’aptitude sensuelle à recevoir les cadeaux de la nature. Son objectif tournait à l'obsession. Il ne croyait franchement pas au destin, et encore moins à la malchance. « Dans la vie, si on se bat, on finit toujours par arriver à ce que l'on veut ». C'était son leitmotiv.
Quelques jours avant la course, il a fait l'inventaire de sa tenue : maillot, short, baskets, chaussettes… Rien ne manquait. Tout semblait correct. Le jour de la course, mon oncle est arrivé tôt en voiture pour l’accompagner. Mais le temps de s'arrêter pour prendre un café, la voiture n'a pu redémarrer. Mon père était marron. Puisque ce n'était pas de la malchance, puisque ce n'était pas le destin, mon père a sorti la poêle du tiroir pour se cuisiner une omelette aux grattons. Ça faisait des mois qu'il n'avait pas mangé gras. Il n'a plus reparlé de la course.
Laurence
Je les ai entendus parler dans la cuisine.
Dans mon demi-sommeil, l'odeur rance du lard frit mêlée à celle de la suie s'entêtait à chatouiller mes narines et des bribes de paroles prononcées par deux voix, celle d'un homme et celle d'une femme, m'arrivaient. Le jour posé sur la vitre d'une fenêtre sans volets, acheva de me réveiller. Les yeux maintenant bien ouverts, je me remémorais mon équipée de la veille et comment j'avais atterri dans cette chambre.
Au petit matin, j'avais pris le chemin pour une belle randonnée. Le ciel bien dégagé, la brise à peine perceptible, c'était l'espoir d'une journée de printemps quasiment idyllique. On m'avait parlé d'un sentier de GR ponctué, entre autres, d'une combe encaissée, d'un raidillon abrupt, malaisé avec ses plaques de schistes instables, d'une forêt dense d'épicéas, d'une longue crête couleur d'albâtre et d'une vue à couper le souffle. Il fallait prévoir bien des kilomètres, mais la longueur du trajet ne m'effrayait pas. J'étais donc partie à l'aventure.cations des autochtones étaient correctes. Combe, raidillon, forêt de résineux, crête et vue, rien ne manquait. Ils avaient toutefois oublié un détail : l'harmonie et la beauté des lieux ; l'enchantement de la combe avec ses flancs tapissés d'une végétation colorée ; l'or des genêts-balais, le rose des couvre-sols, la minéralité somptueuse du pierrier, la majesté des futaies et l'extase de la découverte au sommet de la crête.
Ma contemplation avait duré longtemps. Mes yeux s'étaient noyés dans les éboulis, les arbres, les champs, les balafres des routes, le miroitement des cours d'eau, tout cela cascadait tout en bas, au-dessous du sommet. Mon regard avait aussi découvert un au-delà de cimes et de vallées. Je n'avais pu m'empêcher de méditer sur la sensation ambigüe : faiblesse et puissance, qui m'étreint en de tels lieux.
La barre rouge du soleil couchant m'avait ramenée à la réalité. Il était temps de reprendre la route du retour. J'avais décidé d'emprunter un autre itinéraire plus direct. Perdue dans mes pensées et appliquée à me hâter, je n'avais pas prêté attention aux nuages qui s'amassaient.
La gifle d'une bourrasque, le craquement de branches, l'envol de feuilles, m'avaient fait réaliser que l'orage était proche. Il était là : de larges gouttes s'étaient écrasées sur le sol, un déluge d'eau et de grêle avait suivi.
Aveuglée, j'avais pris le parti de continuer prudemment ma marche dans le caniveau creusé le long de la route, à l'opposé du vide. Une masse sombre où brillaient deux yeux s'était arrêtée. C'était une bétaillère, la « providence », dans laquelle je m'étais engouffrée. Mon sauveteur m'avait laissée devant le Café-Epicerie d'un petit village, en me signalant que la tenancière du lieu pouvait me donner le gîte.
L'accueil de celle-ci avait été des plus chaleureux. Elle s'était empressée de m'installer face à une salamandre où rougeoyaient quelques braises qu'elle avait « tisonnées », avant d'ajouter une bûche. La chaleur m'avait gagnée et engourdie, pendant qu'elle s'activait :
« Voilà des serviettes, je vais vous montrer la chambre, je vous porterai un bol de soupe. C'est un minestrone à ma façon. »
Sur un plateau, elle avait non seulement posé l'écuelle fumante, mais encore des tranches de pain au levain et un gros morceau de fromage. La soupe avalée, je n'avais eu qu'une hâte : m'enfouir sous les couvertures et l'édredon. En moins de deux, j'avais sombré dans un profond sommeil. La clarté d'un jour naissant, des voix, des odeurs m'avaient réveillée.
La veille, recrue de fatigue, je n'avais prêté aucune attention à la chambre. Je la découvrais avec son grand lit où j'avais dormi d'une seule traite, son papier peint d'un vert passé, sa table à écrire patinée par les ans et les efforts d'une ménagère qui s'auréolait de taches plus claires cernées de sombre. Au-dessus de ce meuble, plaqué contre le mur, j'avais reconnu une reproduction de Monet « les nymphéas », avec ses larges corolles de nénuphars alanguis sur un étang calme et sa chevelure végétale…
La senteur familière du café et le soupir de la cafetière qui finit d'extraire le breuvage d'un marron banal mais tellement suave, m'avaient rappelé que j'avais faim et que je devais partir.
Dans la salle aux multiples fonctions : café, épicerie, cuisine, j'avais retrouvé mon hôtesse, Alphonsine, devisant avec un client. Il n'était question que de l'orage et de ses dégâts : des récoltes perdues, des tuiles emportées, des gouttières percées par des grelons gros comme des noix, des talus ravinés.
L'homme soudain m'avait adressé la parole et m'avait invitée à participer à la conversation. Avec le ton sentencieux qu'adoptent parfois les paysans d'un certain âge, il avait remarqué que les citadins, comme moi, étaient préservés des fureurs de la nature, qu'il fallait être attaché à la Terre pour savoir ce qu'étaient le travail et la sueur. Il avait ajouté que les paysans donnent beaucoup mais qu'ils reçoivent peu d'une terre souvent ingrate. Et pourtant qu'ils ne regrettent rien et que pour rien au monde ils n'iraient vivre à la ville. Leur destinée était la terre.
Et de conclure : « La dernière fois que je me suis rendu à Marseille, j'étais encore bien jeune, j'ai cru devenir fou ».
Josette
Avril 2016, Inclusion
La proposition d'écrire un récit à partir de quelques phrases à inclure:
Van Gogh, Nuit étoilée sur le Rhône
Ce soir, je regarde le ciel avec une telle attention que la tête me tourne, que je titube de vertige. On a annoncé une pluie d'astéroïdes. Au-dessus de moi la voûte céleste brille d'un éclat dur. Je la regarde avec l'espoir de voir passer une étoile filante. Mes yeux fouillent l'obscurité profonde, je m'y enfonce lentement. Pour rien au monde je ne voudrais rater la traînée lumineuse qui zèbrera le ciel. J'agis ainsi depuis des années, au mois d'Août.
Que de voeux sont ainsi partis vers ces lointains abîmes qui nous dominent et pour lesquels j'éprouvais de l'amitié. Là, en solitaire, j'avais l'habitude de jouer les confidents, sans attendre de retour, car je savais que ceux qui se confiaient le plus vite étaient ceux qui le regrettaient tout aussi vite.
Cette nuit- là mon attente était plus aiguë que d'habitude, car j'étais loin d'avoir l'esprit à rire : ce qui m'arrivait était vraiment pénible. A trop scruter le ciel mes yeux se brouillent. Avec ma tête rejetée en arrière, ma nuque souffre. La douleur physique me ramène à la réalité, vers cette souffrance morale plus complexe que mes mots, elle outrepasse mes souvenirs : alors pour ne pas la quitter, parfois, je l'invente.
Comment expliquer l'inexplicable ?
Comment montrer ce qui, pour tous, hormis pour moi, est invisible ?
Comment leur dire « Je suis à ma recherche ».
Des compatissants j'en ai bien connu, mais tout autant des regards étonnés. Certes il m'arrivait d'accepter de l'aide, d'écouter pour faire plaisir, mais l'autre sentait bien que ce n'était déjà plus mon affaire, que toute parole était inutile. Ma quête est sans fin comme le ciel que je regarde. Je veux croire au miracle ; je veux aussi l'oubli que je pourrais, peut-être, trouver dans le Bordeaux médiocre mais abondant qui vieillit dans le fût.
Josette
Evitement
J’en ai assez de me réduire à une vulgaire paire d’oreilles. J’attire les gens à problèmes, sans en douter. C’est écrit sur mon visage : « Venez à moi éternels insatisfaits. Venez-vous plaindre, geindre, gémir ! Je suis là pour vous entendre, je suis là pour votre jouissance toute entière. Martelez-moi de votre parole sourde, anéantissez-moi, réduisez-moi à la seule partie de l'autre qui vous intéresse : l'oreille ».
J’en ai marre de cette servitude insensée. Ce soir, je regarde le ciel avec une telle attention que je titube de vertige. Joli ciel crépitant d’étoiles, ouvre-moi tes bras, accueille-moi de ton silence ! Je me donne à toi tout entière : une oreille. Car j’ai beau savoir que tu ne me voleras rien, plus complexe que mes mots, elle outrepasse mes souvenirs : alors pour ne pas la quitter, parfois, je l'invente. Je cherche une voix dans ton silence. Je n'entends rien. C'est la déroute. Je cherche ce que je fuis, paradoxe incontournable qui fait de moi ce que je suis. L’oreille est ma raison d'être. C'est elle qui donne sens à mon existence. Otez-la moi ! Je voudrais tant devenir sourde de ce que je suis ! Que serais-je sans elle ? Je veux, je ne veux pas, je suis tout cela à la fois.
J'étais loin d'avoir l'esprit à rire, parce que ce qui m’arrivait étaient vraiment pénible. Je m'étais lancé un défi : écraser l'autre sous le poids de la parole, lui donner à peine le temps de respirer et le couper, sans scrupules.
Hausser le ton s’il le faut, tout en gardant le sourire. Ou plutôt grimacer, feindre un début de larmes, toucher l’autre dans sa culpabilité, s’il insiste.
C’était ma revanche de toutes ces heures d’écoute où l’on me laissait choir ensuite sans la moindre pitié. La poubelle de l’autre, voilà comment je m’étais construite. L’autre, une partie de moi dont je n’arrivais pas à me défaire au risque de mourir. Ouvrir les portes toutes grandes, sans discernement, et laisser l’hémorragie interne œuvrer.
Autre paradoxe : toute fière, j'ai grandi avec l'habitude de jouer les confidents mais je savais que ceux qui se confiaient le plus vite étaient aussi ceux qui le regrettaient tout aussi vite. J'écoutais à tout-va, pour le meilleur comme pour le pire, le pire étant le plus excitant, bien entendu. Ainsi, j'opérais le plus parfait des alliages entre la douleur de l'autre que je faisais mienne et l’intérêt quasi passionnel que je portais à ses paroles. Le vidage s'opérait dans un second temps, prise dans la répétition d'une histoire sans fin, en attente d'une prochaine écoute, similaire. Petit à petit, je disparaissais.
L’urgence s’imposant, je décidais de vivre l'expérience inverse : envahir l'espace de l'autre. C'était un samedi soir. J'étais invitée à l’anniversaire d’un ami. Tout en me préparant, je me rappelais en boucle mes nouvelles résolutions : « parler plus haut, plus vite, plus fort que mon interlocuteur. Lui couper la parole. Pleurnicher s'il insiste ». La soirée avait bien commencé. L'ambiance semblait bonne. Le Bordeaux était médiocre, mais abondant. Au bout du troisième verre, la tête commençait à me tourner. Mais qu'importe, l’excès du vin me mettait en verve. Au moment du café, une femme bien plus qu’enrobée est venue s'asseoir auprès de moi. Son physique n'était pas sans rappeler une figure maternelle. Je la trouvais attendrissante et agaçante à la fois. J'avais l'habitude de combiner des impressions contradictoires. Aussi, je ne m'en étonnais pas. Puis elle s'est mise à me parler de ses petits-enfants. Puis de la distance géographique qui la séparait d’eux. Puis qu’ils ne l’appelaient pas souvent au téléphone. Puis qu'ils n'étaient qu'une bande d'ingrats, que personne ne se souciait de sa solitude. Je l'écoutais pour lui faire plaisir, mais elle sentait bien que ce n'était déjà plus mon affaire. Je ne lui coupais pas la parole pour autant. Tandis que la dimension dramatique de son discours allait croissant, sans doute pour regagner mon attention, une petite voix intérieure me disait : « Ferme la porte et écoute-là. C'est tout à fait conciliable. Il suffit de t'entraîner un peu et tu découvriras des choses nouvelles ». Je n'ai pas écouté cette petite voix intérieure. Qui sait si ce n'était pas un piège pour me renvoyer à ma propre aliénation ?
La piste de danse s’emplissait de monde. J'ai prétexté mon envie compulsive de danser pour mettre un terme au monologue. L'évitement, telle était ma dernière trouvaille, peut-être pas la meilleure, mais la plus efficace, dans l'urgence.
Laurence
Vertige aux étoiles
On se connaissait bien et depuis longtemps. Une belle amitié d’adolescents qui avait atteint la maturité sans la moindre équivoque. Ce soir-là, elle avait eu besoin de parler, de faire le point. Je sentais que c’était important, que ça la touchait vraiment. Ses démons, elle n’y arrivait plus toute seule. Elle avait besoin de quelqu’un de confiance pour l’aider à les exorciser.
S’il y avait quelque chose en elle qui m’avait toujours fasciné, c’était sa clairvoyance, sa solidité, une assurance à toute épreuve et, bien sûr, il ne m’avait pas été désagréable qu’elle me demande mon aide. Elle avait besoin de parler ? Bien sûr, sinon à quoi aurait servi l’amitié ?
Les flammes dansaient à travers nos verres. On était bien.
Le Bordeaux était médiocre mais abondant, on ne manquerait pas de munitions. Si la qualité n’était pas au rendez-vous, ça ferait quand même l’affaire, elle avait juste besoin de décoller. Et puis l’ambiance était chaleureuse et j’étais heureux d’être là avec elle, ça compensait largement. Le passage de la trentaine avait été un épanouissement, elle était très belle.
Vers la fin de la première bouteille, décollage réussi. Elle planait. Elle me regardait mais je voyais qu’elle était plongée dans un autre monde. Je souriais en la voyant s’enfoncer doucement dans le fauteuil et la robe remonter un peu.
Le vin aidant, elle me parlait de « lui », « lui » qui ne se rendait compte de rien, « lui » qui n’imaginait pas ce qu’il provoquait en elle. Elle parlait de trouble. C’était de plus en plus intime et pour tout dire un peu chaud avec juste une petite lueur au fond des yeux. La magie du vin, même médiocre.
J’avais l’habitude de jouer les confidents, je savais que ceux que se confiaient le plus vite pouvaient le regretter. Mais elle avait pris son temps et notre complicité fraternelle était rassurante. Je n’imaginais pas une seconde qu’elle puisse regretter quoi que ce soit. Moi, je me sentais bien dans le rôle. Flatté par la marque de confiance et même touché d’être admis sans pudeur dans sa vie très secrète. J’étais très sûr de moi dans ma « mission ». Je n’allais pas tarder à l’être beaucoup moins.
Je l’écoutais avec juste ce qu’il faut de distance pour ne pas m’impliquer personnellement et l’attention nécessaire pour favoriser la suite. Jusque-là tout allait bien.
Et puis c’est arrivé. Une petite chose insignifiante mais je commençais à avoir du mal à la suivre. Je ne savais pas pourquoi.
Une gêne s’installait en moi, grandissait et un nœud se serrait au fond de ma gorge. Qu’est-ce qui m’arrivait ? Je ne comprenais rien. Elle, elle continuait comme si de rien n’était. Elle souriait. Elle s’enfonçait encore un peu dans le fauteuil.
Je tentais l’humour pour sortir de là mais j’étais loin d’avoir l’esprit à rire parce que ce qui m’arrivait était vraiment pénible.
Et puis une petite lumière...
Mais que c’est con un mec… son « lui » n’était pas n’importe qui, son « lui », c’était moi.
Ils étaient là ses démons et je n’étais plus capable du moindre détachement. Curieusement je m’en voulais.
À présent je l’écoutais pour lui faire plaisir et me donner le temps de retrouver mon assurance, mais elle sentait bien que je n’étais plus à son affaire. Ou bien trop. Arthur avait trois ans, Clothilde était enceinte, ma vie était bien pleine, bien arrangée et je n’avais pas besoin de son joli complot.
Elle s’est redressée dans le fauteuil en tirant sur sa robe. Un pauvre sourire sur les lèvres. Nous n’avons pas ouvert la deuxième bouteille.
J’ai tout fait pour éviter de la revoir mais le malaise n’avait pas disparu, incrusté là, tout au fond. Il y était resté.
Ce soir je regarde le ciel avec une telle attention que la tête me tourne, je titube de vertige. Je cherche une issue que je ne trouve pas. Ce soir je ne sais vraiment plus où j’en suis et là, ce n’est pas le Bordeaux.
Elle a éveillé quelque chose en moi, une chose dont je ne veux pas. Mais c’est là.
Cette histoire est plus complexe que mes mots, elle va bien au-delà de la colère de m’être fait piéger, de ne rien avoir vu venir, de ne pas m’être protégé.
A force de me la repasser en boucle, je sens que l’histoire outrepasse mes souvenirs. Avec le temps je ne suis même plus certain de son rapport exact avec la réalité.
Cette histoire que j’ai voulu oublier, je la cherche maintenant. Alors pour ne pas la quitter, parfois j’ai l’impression que je l’invente.
Un rêve ou une réalité ?
Mais que c’est con un mec…
Yves
Dans mon pays...
Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté.
René Char
Dans mon pays, le sable est doré toute l’année.
L’eau est si douce qu’on peut s’y baigner à volonté.
Les pierres ont la couleur de l’herbe fraîche et la douceur de l’éponge.
L’hameçon ne blesse pas le poisson. Il l’élève dans les airs.
On ne mange pas dans mon pays, on respire.
Les bâtons ramassés ça et là donnent le tempo de la danse.
Des banderoles colorées viennent s’y greffer. Le drapeau universel est né.
Traces de pas emmêlés, battements de cils, regards dilués.
L’air est frais et prospère. Pas besoin de partager.
Les mots virevoltent mais ne frappent jamais.
Symphonie des sons, notes de musiques ajoutées. Harmonie est le mot-clé.
Seul le juge est affolé. Il ne travaille jamais.
Les dictionnaires sont amputés, désagrégés, rendus à l’inutile
Les barrières sont levées.
Les mots se sont envolés, à jamais.
Plus besoin de parler.
Laurence, mars 2016
Dans mon pays, mais quel pays ?
Celui, là bas, d'où ma famille vient ?
Celui, là bas, où je suis née ?
Celui, ici, où je suis établie?
Orient, Afrique, Europe.
Fondus. Même identité
En moi, les cultures se répondent
Se conjuguent et me façonnent
En moi, trois langues pour dire bonheur et quotidien
Malhaba, anisoroma, bonjour
En moi, non pas éclatement mais régénération.
Une histoire personnelle
Mes ancêtres y sont phéniciens, bambaras, gaulois.
En moi, Byblos, Mopti, Provence,
Litani, Niger, Rhône,
Cèdres, manguiers, chênes,
Paysages variés qui se font écho.
En moi, multiples références mais unité de vie.
Fabienne, mars 2016
Nue
Dans mon pays
Vieille veste
Aux épaules
Ici ou ailleurs
Dans mon pays
Une tête penchée
Un sourire esquissé
Les mains posées
Tranquilles
Et ses yeux dans les tiens
Attendent
Dans mon pays
Sans guide, sans catalogue
Sans histoire de l’art
La peinture
Te prend
Par la main
Te parle
Dans mon pays
Le sourire du père n’est pas rien
Pas de mise
Le sourire te regarde
Faire
Tu ne sais pas pourquoi
Tu es fier
Son sourire et tes portes fermées
S’ouvrent
Il n’y avait pas de clef
Dans mon pays
La mort
Etrange et familière
Une amie en chemin
Et si rien
C’était bien ?
Tu peux sourire
Dans mon pays
L’eau
Eclabousse
Saute
Ruisselle
Vagues
Immergée
Gouttes
Sur ta peau
Quand tu sors
De l’eau
Nue
Yves
Elle ...
Opacité
La télé va trop fort, mais elle ne l'entend pas. Assise dans son fauteuil troué, elle élève ses pauvres jambes bleutées sur un vieux pouf rescapé de Pologne. Elle somnole. Sa pauvre tête, qui s'affaisse sur l'épaule, se soulève au rythme de sa respiration. Sa bouche, pareille à un bec, s'ouvre et se referme dans un mouvement abject. Elle est laide. Ses cheveux de paille, gras, délavés, encadrent son visage bouffi, cerné, malade.
« Le professeur d'anglais ne me croyait pas quand je lui disais que je ne me maquillais pas ». Son esprit s'est figé vers le passé. Elle rêve : belle, séduisante, elle n'a pas encore raté sa vie. Juste sa jeunesse, mais ça ne se voit pas. Son visage est lisse, magnifiquement sculpté. Deux pommettes saillantes s'offrent généreusement au regard de qui lui vole un sourire. Mais aussi, deux petites virgules au coin de ses lèvres pour donner l'alerte, deux petits sillons raides et droits, si profonds déjà.
La télé va trop fort mais elle ne l’entend pas. Ses mains joufflues s'écrasent sur son corps difforme. Elle est laide. Maigrir, le mot-clé du médecin. Mais elle ne l'entend pas, elle s'en fout : se remplir, c'est sa respiration. Ses jambes se sont arquées avec le temps, avec le poids aussi. Des papiers de bonbons jonchent le sol. Elle fait du diabète, et elle s'en fout. Au rebord de son pull, un bout de chair grasse apparaît. Bleue la chair, comme ses jambes, chair meurtrie jour après jour des piqûres intrusives de la médecine, antidotes illusoires aux blessures de la vie. Manger des bonbons, des chocolats, des gâteaux. Elle n'est plus au lycée cette fois. Elle a 11 ans. Elle ne verra plus sa mère, sa mère de cœur, sa mère de lait, comme on dit.
La télé va trop fort, mais elle ne l'entend pas. Ses paupières tremblent, s'agitent. Ses yeux s'entrouvrent. Un bruit grotesque s'échappe de sa gorge. Un instant, elle ne sait plus où elle est. Elle est laide. La lumière a baissé. Pourtant il fait jour. Il n'est que 14 heures. Le ciel s'est chargé de nuages. Il va pleuvoir. L'évier est encombré de vaisselle sale. Il va falloir se lever pour laver tout ça. Ça fait mal de bouger, de porter le poids de ce lourd corps sur ces deux jambes asphyxiées. Pas d’air, pas d'oxygène ne semble circuler dans ce pauvre corps.
Elle se lève, enfin, péniblement, jetant au passage un regard vide vers la télé. Elle ne l'entend pas, ne la voit pas. A peine. Sa vie, son univers, son espace se sont focalisés sur ces quelques années de jeunesse qui ont précédé le mariage, avant la bascule, quand on croit qu'on ne pourra plus jamais faire marche arrière. Elle y pense, elle y retourne sans cesse. Elle cherche le regret, mais elle ne le sait pas.
Elle remplit l'évier d'une eau chaude, propre, savonneuse. La vaisselle glisse d'une main à l'autre et s'achemine vers l'égouttoir. Le café est en train de passer. Le téléphone sonne. Elle décroche, les mains encore humides. On l'entend se plaindre, gémir, pousser des soupirs sans retenue. C'est sa fille de Paris qui l’appelle. Elle sait qu'avec elle, elle peut se lâcher. Puis elle raccroche, ne sachant pas qu'elle a laissé passer un moment heureux.
La pluie s'est mise à tomber. Le mari arrive. On le croyait absent. Pourtant il est là, mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas non pas parce que c'est lui, mais parce qu'elle ne le peut pas. Ce serait s'accorder trop de vie alors qu'elle cherche la mort depuis toujours. Mais elle ne le sait pas. Elle pose les tasses à café sur la table et attrape quelques chocolats dont elle se remplit la bouche. Elle a tout le temps faim. Mais de quoi ?
A soixante- seize ans, son corps continue de chercher l'aliment miracle qui la comblera. Elle y croit et elle mange. Sans fin. L’infirmière sonne à la porte pour la piqûre. Son diabète s’est aggravé. Tout le monde s'inquiète. Sauf elle. Elle en rit, menaçante, agressive. C'est comme ça qu'elle existe, dans la maladie qu'elle affiche, qu'elle provoque, qu'elle entretient. Elle cherche la mort depuis longtemps. Elle y arrive, bientôt.
Laurence, février 2016
De l’art du portrait et autres curiosités, janvier 2016
Inspiré de Mr Gwyn, de Alessandro Baricco
Assis par terre, il regarde la plante de ses pieds. Bien sûr on n’a pas nettoyé ici depuis des années.
Dos au mur, en pantalon de mécanicien, il regarde la plante de ses pieds.
« Tu crois que c’est simple... »
L’atelier ouvre sur une vaste cour. Elle regarde la cour, une fine chaine à la cheville. Les pointes de ses seins effleurent la vitre.
Dans la cour un jeune homme pousse son vélo. Il tourne légèrement la tête. Il la regarde. Elle esquisse un sourire. Tout est si naturel.
Torse nu, il regarde la plante de ses pieds. La poitrine se soulève.
« Tu crois que c’est simple...»
Petites lunettes cerclées, moustache cirée, un homme marche dans l’atelier. Une chaise. Il s’arrête, s’assied, tourne légèrement la tête. Par la fenêtre il regarde la cour. Il ne pose pas. Le sexe circoncis pend sur sa cuisse. En face de lui le peintre regarde la plante de ses pieds, il ne peint pas.
« Tu crois que c’est simple... »
Étendue sur le canapé fatigué, obésité juvénile, visage de madone. Elle se caresse, les yeux ouverts. Il voit le dessous des pieds de la jeune fille. Longuement, elle avait dansé entre les pages du carnet épinglées sur le parquet. Fascinante de légèreté. Le dessous des pieds. Bien sûr on n’avait pas nettoyé l’atelier depuis des années.
Elle ne pose pas. Il ne peint pas. Il regarde la plante des pieds de la fille.
« Tu crois que c’est simple... »
Les lampes se sont éteintes trois fois. Trois fois la porte s’est refermée sans un mot. Les trois modèles partis, il a peint les trois tableaux d’une seule traite.
Dans la galerie un couple va lentement d’un tableau à l’autre, s’arrête, revient.
Femme nue à la fenêtre regardée par un jeune homme au vélo.
Homme à la moustache cirée. Portrait en pied.
Jeune fille se caressant.
Les tableaux sont dérangeants, accomplis. Qu’est-ce qui est si étrange ? On aimerait infiniment être dans ces tableaux. Le couple cesse de déambuler. Ils se regardent intensément. C’est elle qui rompt leur silence : « C’est tellement simple... »
Yves
Printemps des poètes 2016
Ma maison natale, qui ne l'est pas...
Autour de ma maison natale qui ne l'est pas
Il y a l'Afrique
Chaleur, bruit, odeur, poussière par les fenêtres ouvertes
Il y a les vendeuses de cacahuètes
Les lépreux qui mendient le jeudi
Les miliciens en patrouille
Dans ma maison natale qui ne l'est pas
Il y a une grande salle à manger
Un matin de Noël, rempli de jouets, de cadeaux, de paquets.
Visages émerveillés de deux petites filles
Dans ma maison natale qui ne l'est pas
Il y a un séjour et mon père s'y repose
Sur fond de musique classique
Elle ravive aujourd'hui dans mon cœur
La chaleur de son amour.
Dans ma maison natale qui ne l'est pas
Il y a notre chambre à trois lits
Alors que nous ne sommes que deux
Invitation pour nos cousines à dormir chez nous
Des lits clos de moustiquaires
Les insectes ne passent pas
J'y suis Robinson dans son île déserte
La porte vers la salle de bain est un tableau noir
Où dessiner un avenir rêvé
Dans ma maison natale qui ne l'est pas
Il y a au fond, la chambre des parents.
À l'heure de la sieste, en chemise de nuit
Maman qui brode, bavarde avec soeurs ou nièces.
Dormir aujourd'hui dans ses draps donnent l'illusion
De me blottir dans ses bras aimants.
Dans ma maison natale qui ne l'est pas
Il y a un jardin
Au fond, la cuisine où officie Tcheba, le boy.
Dans un coin, un escalier
Monte vers l'infini.
A l'abri du soleil brûlant
Les branches du manguier
Accueillent la cabane où nous jouons à être grandes.
Il y a la niche du chien qui dévore nos desserts sous la table
Le vieux matou qui dépose son butin devant le portail
La chatte qui nous offre ses chatons nouveaux nés
Et ces fauteuils où un jour,
Des hommes magnifiques aux somptueux boubous
S'installent et demandent à mes parents
La main de Bintou, la mousso bambara
J'ai dix ans et ma maison natale qui ne l'est pas,
Tout au bout de la rue
C'est la maison de mon enfance heureuse.
Fabienne
L'intruse, janvier 2016
J'étais là, à rêver, allongée sur l'herbe fraîchement coupée et qui distillait cette odeur particulière : une fraîcheur acide, un peu enivrante. J'étais grisée, peut-être était-ce la raison de ce terme qui surgissait, sans explication apparente, dans ma demi-somnolence. Vocable sacré, sacralisé auquel nous nous attachons et qui nous rattache aux autres. Je me dis: " Faisons un examen de conscience. Suis-je marquée par telle ou telle famille ? Laquelle ?" Ce groupe là est bien structuré autour de la mère. Certains penseront que j'évoque la « mama », ce personnage typique et fort du Sud de l'Italie. En fait, Angelina est l'émanation, la quintessence de toutes les mères du pourtour méditerranéen. Avec sa petite taille, elle les domine tous : mari, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, nièces, neveux, parents, alliés et amis. Elle ne semble pas commander mais tous lui obéissent. Les services qu'elle demande, et Dieu qu'ils sont nombreux ! sont perçus comme des aides, quasiment des cadeaux. Etrange situation… Elle n'a pas son pareil pour organiser les réunions familiales. C'est chez-elle, et pas ailleurs que le ban et l'arrière ban se plongent dans cette « marmite » où bouillonnent l'affection, l'amour, tous les bons sentiments. Elle s'est rendue indispensable : elle gère la vie des siens tambour battant. Combien de fois s'est-elle mise en quête d'une épouse pour son fils divorcé ? 1, 2, 3 plusieurs fois, je pense, et choisies selon certains critères : bien nanties, travailleuses, dociles... entre autres. Ces couples artificiels fonctionnaient pendant quelques temps puis s'essoufflaient et disparaissaient. Jusqu'au jour où le fils est arrivé avec la femme de son choix. Lassé, peut-être, par l'omniprésence de sa mère, mais, et cela semble plus vrai, ensorcelé par la rayonnante Lisbeth. Les coups de foudre existent. Elle est apparue, un beau jour, si différente physiquement des jeunes femmes présentées par sa mère, des brunes de cheveux et d'yeux, sans signe particulier et, intellectuellement bien au-dessus de ces dernières. Lisbeth c'est le blé doré des cheveux et l'azur du regard, le sourire permanent de celle qui assure. Très vite, le fils lui a ouvert sa maison. Le grand piano, elle est une très bonne musicienne, a trouvé le premier, sa place, dans le séjour et les autres meubles n'ont pas tardé à suivre. La maîtresse de maison, c'est elle, désormais. Angelina n'a pas résisté très longtemps ; elle avouait sans avoir l'air de rien « Lisbeth c'est une main de fer dans un gant de velours ». Limogée, répudiée, Angelina peu à peu a cédé du terrain. Elle n'a plus ses entrées libres dans la maison de son fils. Sa bru, car le couple a officiellement convolé, l'invite à l'occasion. Un bourdon tourne autour de moi, son vol et son vrombissement m'agacent, ma pensée s'effrite... Josette
Lettre ouverte à mes profs de français...
Président de l'OULIPO ( Ouvroir de Littérature Potentielle) depuis 2004, Paul Fournel définit la contrainte d'écriture :
"La contrainte agit d’abord comme un stimulant de la création : bornant l’imaginaire, elle fait paradoxalement prendre conscience à l’écrivain de l’étendue de sa liberté, d’où son efficacité en matière de production du texte. Le texte jaillit, ici et maintenant, poussé par une nécessité externe qui permet de lutter contre les vents internes qui pourraient se montrer contraires.
La contrainte permet ensuite de remettre en cause les formes de textes, établies par soumission collective (consciente ou inconsciente) ou par habitude du temps. Elle est alors un outil de questionnement de la forme et du sens. Les « lourdes chaînes du sens » passent au second plan et on peut ainsi voir comment la contrainte choisie malmène ce sens et lui donne une chance de se renouveler."
On écrit en atelier d'écriture comme on ne nous a pas appris, ni autorisé à le faire, dans nos cursus scolaires. On écrit en liberté. une liberté qu'exerce Yves, avec humour et légèreté, dans sa "Lettre ouverte à mes profs de français".
En sortant de l’école...
Non ! pas de l’école...
Marseille, en sortant de l’atelier d’écriture Au clair des mots le 23 janvier 2016
Lettre ouverte à mes profs de français.
62 ans et je me souviens à peine d’aucun de mes profs de français.
Oui, oui, vous avez bien lu. Je vous entends ricaner mes chers profs de français en affutant vos stylos à bille rouges. (d’ailleurs, comment accorde-t-on « rouge » ? « s » ou pas « s » ? Mais bien sûr, « rouges » avec « s », ce n’est pas la bille qui est ... ce sont les stylos. Ou alors « rouge » sans « s », c’est l’encre qui est... pas les stylos. On n’en sortira pas mais vous voyez, j’étais là.)
« Je me souviens à peine d’aucun de mes profs de français ».
Cette phrase « incorrecte » est là parce que cette lettre vous est adressée et que, sous cette forme, la phrase dit exactement ce que je ressens aujourd'hui, avec le brin d’insolence que je sens monter en moi.
Si cette phrase ne m’avait pas plu, si elle avait écorché mon envie de justesse, je l’aurais retirée sur-le-champ.
Mais elle est là, je l’y laisse.
Affutez, affutez, mes chers profs de français, vos stylos rouge (pas de « s », c’est l’encre qui est rouge, pas les stylos ou bien...)
« Ne aucun. On ne peut pas associer aucun dans une phrase affirmative ». Vous voyez, j’étais là.
« Si tu te souviens, à peine, c’est que tu t’en souviens, tu ne peux pas écrire « aucun » si tu t’en souviens».
Rompons là !
Si je me souviens à peine de vous c’est que vous avez dans mon souvenir, à peine un visage, à peine un nom mais aucun d’entre vous ne m’a permis de sentir le bonheur qu’il y avait à écrire, à suer sang et eau sur une phrase qui n’a pas encore trouvé sa juste expression, son rythme, sa musique. Vous ne m’avez pas fait sentir, mes chers professeurs de français, qu’il y a de la jubilation à la lire, à la relire, à la lire à haute voix cette maudite phrase, quand elle s’est enfin accomplie. Accomplie par moi, par vous, par d’autres, peu importe.
Vous voulez un exemple ? Juste un, pour le plaisir. Il n’est pas de moi, j’aurais aimé... Il est de Georges. Vous savez, Georges, celui du Gorille. Censuré. Plusieurs années.
Tout à coup la prison bien close
Où vivait le bel animal
S'ouvre, on n'sait pourquoi. Je suppose
Qu'on avait dû la fermer mal.
Je vous en veux, mes profs de français, d’avoir essayé de me faire honte. Honte d’avoir osé écrire en dehors des clous. Au lieu d’avoir encouragé mon envie d’écrire, de m’avoir poussé à la créativité.
Je vous en veux, mes profs de français, de ne pas avoir nourri la petite flamme.
Je vous en veux, mes profs de français, d’avoir ignoré mes portes dérobées, de ne pas m’avoir fait deviner ce qu’elles cachaient. (J’aurais pu ne pas en vouloir si vous m’aviez assuré que, de toute évidence, vous n’aviez jamais eu vent des vôtres).
Je vous en veux, mes profs de français, de m’avoir fait étudier Prévert et Villon et de ne pas y avoir cru. De les avoir expurgés, de les avoir censurés, de les avoir châtrés.
Je vous en veux mes profs de français de ne pas m’avoir aidé à écrire poésie.
Je vous en veux mes profs de français. Je vous en veux de...
Non, finalement je ne vous en veux plus.
Je ne vous en veux plus, mes chers profs de français, parce que vous êtes arrivés trop tard dans l’histoire pour avoir pu faire l’autodafé dont vous auriez rêvé. L’autodafé des poèmes de Brassens et de tous les livres que j’ai aimés. L’autodafé de mes compagnons de vie. Des poèmes et des livres lourds de sens et de style. Des poèmes et des livres qui n’ont pas été émasculés par vos commentaires convenus, autant qu’imposés, qui n’ont pas été émasculés par la sélection officielle des « meilleures pages de...». Des textes qui ne respectaient pas toujours les règles grammaticales. Ni les autres d’ailleurs.
Non, je ne vous en veux plus, mes chers profs de français, parce que vous n’avez pas réussi à déquiller le petit bonhomme perché sur mon épaule qui me disait à l’oreille « Bah, ne les écoute pas, ça ne vaut pas la peine de te frapper pour ça. ».
Le petit bonhomme n’a pas pris une ride. Le petit bonhomme perché sur mon épaule qui me dit aujourd'hui « Vas y, écris la musique des mots qui soufflent dans ta tête. Si ça ne vient plus, va pisser un coup. Regarde les gabians dans le ciel. Respire et arrête de faire du bruit avec tes casseroles, tu les rangeras plus tard. Arrête je te dis, de taper sur tes couvercles, tu ne peux plus rien entendre en faisant ce bordel. Calme-toi mec et écoute-moi. »
Le petit bonhomme perché sur mon épaule, vous ne l’avez pas eu.
Je ne vous en veux plus, mes profs de français, parce que vous ne m’avez pas empêché de retrouver les copines et les copains de mon atelier d’écriture.
Les copines et les copains qui sont si différents de moi mais qui n’ont pas de stylo rouge.
Les copines et les copains qui n’y croient pas toujours mais qui prennent du plaisir à écrire, à lire, à écouter. Du plaisir à se laisser étonner.
Les copines et les copains qui ont le droit de dire « Là, ça ne marche pas tout seul si tu ne m’expliques pas », le droit de dire ce qui leur plait et qui disent quoi et pourquoi.
Je ne vous en veux plus, mes profs de français, parce que vous ne m’avez pas empêché de retrouver celle qui vous ressemble si peu. Celle qui nous accompagne et qui nous donne, de sa voix chaleureuse, les encouragements qui nous font dépasser nos limites. Celle qui nous fait cadeau de ses impressions à la lecture de nos pauvres textes, juste comme ça. Ses impressions à nous lire, qui résonnent longtemps, pour qu’on aille plus loin.
Je ne vous en veux plus mes chers profs de français. Je ne vous en veux plus parce que ...
Si, je vous en veux
Encore un peu
Mais on s’en fout
C’est pas grave.
[..]
Yves
PS : « Il n’y a pas de problèmes. Il n’y a que des professeurs. » (Jacques Prévert)