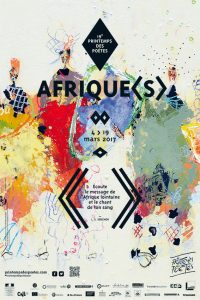Textes
Des "premiers jets", des occasions de se frotter à sa propre écriture et à celle de l'autre, quelques textes écrits en ateliers...
Atelier nomade… Voyage voyage
24 août 2018
Redortiers, 9 et 10 juin 2018
Si jamais vous passez par chez moi […] je vous montrerai un spectacle étrange : une région de collines et de plateaux où dorment sept à huit petits villages absolument déserts. L’herbe pousse dans les ruelles, les toitures s’enfoncent, les orties fourrent les fenêtres basses. Un grand silence les enferme […] . Lettre de Giono à Lucien Jacques, 1922.
Le Contadour, dans les actuelles Alpes de Haute Provence. L'atelier d'écriture ce mois de juin, c'était là, non loin du Moulin, tout près de la ferme des Graves, où vécut Jean Giono.
Apprentissages
Quatre chevals. Non, chevaux ! D’accord, « 4 chevaux », mais en fait on l’appelait « 4 pattes ».
« 4 chevaux, 4 portes, 444 mille francs. » C’était la « réclame » de Renault pour donner envie aux français d’acheter la « 4CH ». Celle-ci n’était que l’autre voiture de la tribu. Elle eut été bien trop petite pour avaler les quatre garçons, et le père, et la mère, et les bagages, et le reste.
Imagine un peu, verte.
Verte comme une olive avec une petit coffre ridicule sous le capot avant. Un coffre déjà à moitié rempli du passage des roues, du cric et de la manivelle, de la roue de secours, et de la batterie. Pour la batterie je ne suis plus certain. Tu sais, elles sont loin les années 50 et ma bonne mémoire aussi.
Avec ou sans batterie, dans le peu de place qui restait dans le coffre, le père avait mis une trousse à outils, des chiffons graisseux que la mère refusait de laver, une peau de chamois toute cartonnée et deux gourdes en alu cabossées.
Les gourdes cabossées, c’était de l’eau pour le radiateur, « au cas où », dans les grandes montées.
Avec la « quatre pattes » vert olive, il n’avait jamais eu besoin de sa réserve d’eau, mais le père était prudent. Il faut dire qu’il avait commencé sa carrière automobilistique avec un des premiers modèles de voiture démocratisée, une Celta 4 d’occasion, avec des freins à câbles devant et derrière. Pas vraiment efficaces, les freins et un radiateur qui se mettait à écumer dès qu’il entendait parler de montée.
Depuis la Celta 4, le père avait gardé l’habitude d’anticiper ses freinages et de mettre dans le coffre des gourdes pleines d’eau… qu’il ne fallait surtout pas boire. C’était de la vieille eau et c’était pour le radiateur.
Bref, le moteur, lui, était à l’arrière sous un capot arrondi, vertical, comme un bouclier-écu, pointe vers le bas, aéré de petites lames inclinées.
Mais oui, ça me revient, la batterie était là, à l’arrière, à côté du moteur. Un moteur tout simple et pas très gros. Il y avait de la place sur les côtés, on pouvait y mettre les mains, faire l’entretien soi-même et même des réparations pour les plus dégourdis.
Essaye un peu de faire la même chose maintenant, avec ta belle voiture…
Donc, devant, le coffre à bagage, bagage sans « s », au singulier. Entre le cric et les gourdes cabossées, on ne pouvait glisser qu’un seul sac de voyage.
Le père se servait de la 4CH vert olive pour son travail et pour nous rejoindre en fin de semaine lorsque nous étions en vacances avec la mère, une sorte de voiture de secours et moi, je mettais mes petites mains sur le volant immense, bien assis sur les genoux du père.
Plus tard, je passais les vitesses, complétement couché sur le côté pour atteindre le levier vertical, tout en bas, entre les deux sièges avant. Dans cette position, je ne voyais plus la route, mais le père était là, qui tenait le volant. Moi je passais les vitesse et j’étais le roi du pétrole.
Á douze ans mes jambes se sont allongées, mes pieds atteignaient enfin les pédales de la 4 pattes vert olive. On gardait les voitures bien plus longtemps qu’aujourd’hui, on attendait qu’elles meurent dans nos bras, avant d’en acheter une autre. Elles nous voyaient grandir.
Le père m’avait initié au secret du démarrage en côte. Un savant mélange d’embrayage, de « champignon » et de frein à main. Le père appelait « champignon », l’accélérateur. Un champignon qu’il fallait « écraser » quand on voulait doubler. Quand j’étais petit, les camions étaient très gros, ils roulaient très lentement et crachaient noir-épais-qui-pue. Il fallait les doubler
Á seize ans, nuitamment, j’empruntais la 4CH vert olive. Première escapade avec mon amoureuse, sous la lune camarguaise.
Le père n’a jamais rien su de ce premier acte délictueux, ni de ma découverte cette nuit-là d’un autre usage de la voiture…
Cinquante ans plus tard, je me plais à imaginer le père faire semblant de ne pas m’avoir entendu partir avec la 4CH vert olive et s’endormir avec son petit sourire en m’entendant rentrer, bien plus tard.
Le père avec son petit sourire, qui n’aurait jamais rien dit à la mère.
Yves, le 10 juin 2018
Les personnages
19 mars 2018
" Un jour ils sont là. Un jour, sans aucun souci de l'heure. On ne sait pas d'où ils viennent, ni pourquoi ni comment ils sont entrés. Ils entrent toujours ainsi, à l'improviste et par effraction. Et cela sans faire de bruit, sans dégâts apparents. [...] Ils: les personnages". ( Sylvie Germain, Les personnages)
Alors on s'est lancés! Avec François Bon et sur les traces de Matt Olbren, nous sommes allés à leur rencontre, leur inventant des petits matins, des travers, des secrets, des ombres et des lumières,"nourris de nos rêves et de nos pensées"... Et c'est une autre histoire... mars 2018
Année 2018
19 mars 2018
BONNE ANNEE!
Les derniers jours des Escales méditerranéennes au musée Regards de Provence, à Marseille, et la proposition de recenser Ceux qui..., à la manière de Prévert, inspirés par la très belle exposition au Regards...
Ceux qui aux mains calleuses Ceux qui portent et qui soufflent Ceux qui poussent Ceux qui tractent Ceux qui se courbent et qui souffrent Ceux aux charges si lourdes Ceux qui courbent l’échine Ceux en haillons Ceux qui roulent les tonneaux Ceux qui chargent les bateaux Ceux qui vendent Ceux qui marchandent Ceux qui achètent Ceux qui s’enrichissent Ceux qui aboient des ordres Ceux qui papotent Ceux qui bavassent Ceux qui bourgeoisement Ceux qui promènent en rubans Ceux qui rêvassent Ceux qui lisent Ceux qui chapeau de paille Ceux qui flemmassent en organdi bleu Ceux qui peignent Ceux qui se chauffent au soleil Ceux qui naviguent de guerre Ceux qui voguent à la voile blanche Ceux qui braquassent en pointu, Tulututu ! chapeau pointu ! Ceux qui folâtrent Ceux qui hainent Ceux qui aiment sans donner Ceux qui donnent sans aimer Ceux qui enfantent Ceux qui trop vieux Ceux qui très jeunes Ceux qui à la peau flétrie Ceux qui bedonnants Ceux qui déambulent sur les quais du vieux port en ce jour de juillet 1898 à 11h47 Frédérique
Atelier nomade, octobre 2017
19 mars 2018
Quand St Jurs, dans les Alpes de haute Provence, accueillait nos ateliers en balade,où en êtions-nous de "se souvenir"... « Des vies, mais telles que la mémoire les invente, que notre imagination les recrée, qu’une passion les anime. »
Nos oublis, les paysages sonores d'hier et d'aujourd'hui... et les listes de Sei Shönagon, autant de prétextes à l'autofiction, les 28 et 29 octobre 2017, pour un atelier nomade.
J’ai oublié. Pourrais-je dire, j’ai tellement oublié que je ne peux plus rien écrire ? J’ai oublié : eh oui ! Il n’y a plus rien dans ma tête, aux emplacements de la mémoire. J’ai oublié même le néant d’où je viens. J’ai oublié certainement le jour de ma naissance, mais j’ai oublié aussi mon appareil photo. Il paraît que j’en avais fait de si bonnes au mois d’avril. J’ai oublié paraît-il mon rendez-vous et l’itinéraire. C’est ainsi que vivent les poètes. A force d’écrire, ils oublient le reste. J’ai oublié aussi, omis, négligé, perdu, les années révolues, mais aussi ce que j’ai lu hier soir, et peut-être ce que l’étrange lucarne nous a servi aussi. J’ai oublié d’écrire à Monsieur Troussepète ou de faire un message à Madame Truquemuche, pour lui rappeler qu’il faut penser à : arroser les plantes, préparer un gratin, nettoyer les vitres, à penser en somme. Elle n’oubliera pas elle. Elle sait où elle est. J’ai oublié beaucoup de choses. Il suffisait d’y penser, mais penser est ce si facile ? Ils ont oublié tant de choses, c’est tout un inventaire. Gérard
.
Printemps des poètes 2017, couleur Afrique(s)
18 août 2017
Quelques bouquins sur l'Afrique, prêtés, empruntés, de belles photos, paysages, hommes, femmes, enfants... Choisir une photo, un document qui vous inspire, et partir en roue libre le temps d'un récit aux couleurs du continent africain. Narration à partir du dessin « les margouillats à la broche » / Carnet d’Afrique, JANO, Les Humanoïdes Associés La nuit tombe Et, déjà, le margouillat pompe. La nuit tombe d’un coup Et le margouillat allonge le cou. Il y a toujours un margouillat qui pompe sur les murs d’Afrique. Le margouillat, c’est l’aérosol, la bombe Anti-moustiques d’Afrique. La nuit tombe, Les bruits montent, s’élèvent. Des bruits plein de couleurs, Plein d’odeurs et de saveurs, Des bruits qui vous enveloppent. Les feux s’embrasent dans les concessions. Les femmes s’affairent, Les hommes discutent, Le Sage est sage. Les zémidjans, pétaradant, n’ont pas cessé d’aller, lumière vacillante ; Quand ils ont de la lumière… Le zémidjan, la mobylette bleue façon made in china, Le transport en commun, Treizième mois des policiers racketeurs. Il faut bien vivre… Et pendant ce temps-là, le margouillat pompe encore. Jean- Claude Sokey Edorh Ma maison dominait la sienne, une maison en tôle, entourée de bric-à-brac. Je m’approche doucement, discrètement, curieuse : le voir, l’entendre, ses enfants et des pots de peinture partout. C’était calme. Une femme, sa femme, préparait le repas. C’est ce que je me dis. Les enfants jouaient et un homme, 40 ans, la peau noire brillante, me regardait. Grand, beau et, surtout, ancré dans le sol, épaules souples. Rien dans son regard de méfiant, d’interrogateur. Entrez ! Je suis entrée sans crainte. Je suis peintre et poète, voulez-vous visiter mon atelier ? Oui, merci. Des tableaux, qui ont accrochés mon regard. Je ne pouvais plus regarder ailleurs. Il peignait sur de la toile et le fond était un mélange de latérite. Silence. Il parle : « La latérite est ma terre ». C’est leur terre. Mon regard se porte sur un tableau et, avant ma question, il me dit : « Ce sont les pas des femmes qui dansent, qui chantent, qui pleurent. Leurs pas sont gravés dans la latérite. La base de mes tableaux, c’est la latérite sur toile ». Un autre tableau, des jumeaux derrière des barreaux : la prison. Si vous privez une famille de ses enfants, surtout si ce sont des jumeaux, vous la conduisez à la mort. … Je peux vous les acheter ? Marie Femmes d'Afrique Les deux jeunes femmes rient au bord du fleuve. Leurs enfants jouent dans l’eau, s’éclaboussent, garçons d’un côté, filles de l’autre. Les deux jeunes femmes ne sont pas sœurs mais co-épouses d’un homme, Tchéba, qui aujourd’hui, se marie pour la troisième fois. La petite est jolie, c’est sûr. Mais si jeune. 14 ans à peine. Pourra-t-elle supporter les corvées, les travaux des champs ? Et ses hanches sont bien étroites pour accoucher, dans neuf mois, n’importe où, avec elles deux comme sages-femmes. Elles rient. Ce sera si facile de lui rendre la vie dure. Jusqu’à ce jour ennemies, elles se sont liguées spontanément contre l’intruse. Après tout, dit la première épouse, elle ne sera que la troisième. On le lui fera payer. Nos enfants nous aideront à la malmener. Elles ont pourtant revêtu leurs plus beaux boubous, et feront la fête, comme si de rien n’était. Le dimanche à Bamako, c’est le jour du mariage. Mais lundi, elles vérifieront que la gamine, excisée comme elles, était bien vierge. Et a autant souffert qu’elles. Elles rient. Fab
Atelier nomade pour un état des lieux, novembre 2016
25 avril 2017
Ecrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.
Georges Perec
Espèces d'espaces
Deux jours dans le Luberon: l'occasion d'un atelier pour écrire sur nos propres traces...
La trace d'un trajet familier
Avignon- Nyons : 60 kilomètres La tête de la greffière
L’hiver, petit matin, garage
Alexis ouvre la porte de la voiture, jette son sac à dos et se vautre sur le siège avant.
Je m’installe au volant. On a à peine bu un café. Une douche en vitesse. Pas sûre même d’être coiffée.
« De toute façon, toi, tu te coiffes jamais. Y’a même pas de brosse dans cette baraque. »
Sur la route de Violès, une demi heure plus tard.
Apparaissent les Dentelles de Montmirail. Belle lumière. Le jour s’est levé. Mon fils somnole sous sa capuche, j’écoute la Matinale de France inter.
La semaine commence.
Voix intérieure
« Il a souri à nouveau ce week-end. Au fait depuis combien de temps ne souriait- il plus ? Il est vrai que je ne suis pas toujours souriante et que ma propre mère s’en désole quand elle se lance dans le tri des photos. »
7 heures 30
La belle voix de Bashung entre deux nouvelles du monde tel qu’il va. Chanson extraite de son album le plus récent. Je ne sais pas encore que ce sera le dernier.
Traversée du paysage intérieur, le profil de mon fils avec un léger mouvement d’avant en arrière.
Il dort. La route est belle.
Sortie de Vaison la Romaine. Ça monte et ça descend.
On a fait tant de trajets en voiture, tous les deux .
Co- pilote efficace, même à six ans. Ne se trompait jamais sur les itinéraires. Comme quoi, les chiens font parfois des chats, mon sens de l’orientation est plus que vacillant.
Plus tard encore.
C’est l’arrivée sur Nyons. Après avoir traversé une place, la petite montée pour aller au lycée. Alex est réveillé et, depuis cinq minutes, ne cesse de me parler.
Nous sommes un peu en avance. Je me gare pas trop près du lycée.
Encore quelques minutes ensemble.
Il me manque déjà, est tout entier dans ses projets copains, les matchs à venir, le contrôle de maths.
Il est volubile, vif.
« Allez je file, mam. A vendredi »
Il s’élance hors de la voiture. Petit signe sans se retourner.
Des années plus tard, je pleurerai comme une fontaine à chaque vision du film de Xavier Dolan « Mummy ». Il y a une scène où la mère qui parle à son fils adolescent, en voiture, lui dit à peu près ceci :
« Quand tu étais tout petit, j’avais le sentiment que tu m’aimais encore peut-être plus que je ne t’aimais. Et puis, en grandissant, les choses s’inversent. C’est moi qui t’aime de plus en plus et c’est toi qui t’éloignes. »
Je vais boire un café. Double, crème, sans sucre.
L’enfance s’éloigne.
Je reprends la route.
Djamila
Autrefois
Enfance
On a attendu, on a fait traîner, on a cherché des stratagèmes mais au bout du compte, il a bien fallu céder devant les grognements de notre père. La nuit était encore douce et la maison fraîche. Pourquoi rentrer ? Pourquoi quitter le paradis pour la fadeur de la ville ? La voiture est là, bête docile avec son dos rond et l’odeur de ses sièges qui ne sent plus vraiment le neuf. Le coffre est déjà plein, il ne reste plus que les personnages qui entrent en traînant dans l’habitacle.
Ma tête dodeline. Je repense aux moments passés, les amis, les copines, les parties de foot, les balades, les jeux, les rires. Dans la voiture, mes parents parlent mais déjà je ne les entends plus. Que font mon frère et ma sœur, j’ai oublié. Je me souviens du paysage qui défile inexorablement : les champs, les vaches, les bosquets au loin et les souvenirs de vacances qui se bousculent, le rire de Sylvie. Pas de larmes vraiment mais la sensation d’une plénitude infinie qui nourrira les jours sombres et gris de l’automne en ville.
Quand la campagne finit-elle par capituler ? A quel moment le monde de l’enfance est-il dévoré par la mécanique broyeuse du monde des grands ?
Quand le passage à niveau se baisse et que les autos s’entassent comme des insectes serviles, ce n’est plus déjà la campagne et pas encore la ville mais il faut payer un droit de passage, une rançon.
C’est à cet instant que la boîte à souvenirs se ferme et qu’une autre s’ouvre. Celle-ci sent le ferment brumeux du gris des murs. Elle sent l’odeur de l’essence et des rues humides et grasses. Après, le rythme s’accélère, les immeubles jettent un regard sévère sur la 403 qui se hâte. Puis une longue ligne droite et le parking. Je tente de m’accrocher à des lambeaux de rêve. Rester encore un peu. Garder au chaud mes souvenirs. Il faut pourtant sortir, porter quelques sacs.
Les réverbères, ces géants anonymes, ne clignent pas des yeux. Ils sont immobiles et rassurants.
Ils t’ouvrent la ville et tu cherches en vain à leur en vouloir. Ils sont restés fidèles pendant que tu caracolais dans ton havre de verdure. Ils t’ont attendu, muets, pour t’accueillir, pour que tu ne te perdes pas. Il fait nuit mais il fait clair. Tu sais déjà que tes souvenirs d’enfance s’effaceront et que même ces cerbères dociles finiront par mourir. Alors tu avances. Tu sais sans savoir. La suite, tu la connais par cœur ; la lourde porte de l’allée, l’odeur de granit, la dureté de la pierre, les coquillages incrustés dans les marches, le monde minéral domestiqué que tu foules de ton pas d’enfant. Et cette montée vers le refuge, cette ascension inexorable. Tu ne peux pas y échapper sinon en comptant : un, deux, trois, quatre…Il n’y a pas d’issues, on ne peut pas redescendre et cette montée vertigineuse te donne le tournis. Tu vois tes aïeux un à un disparaître et bientôt c’est le palier, la porte massive et vernissée, une porte ancienne, travaillée, artisanale.
Roland
Quelques coups d'oeil dans le rétroviseur...
J'ai en moi deux images d'un passé lointain reconstruit, qui ne s'annulent pas mais se superposent.
Je me souviens. J'ai 7 ans. Rencognee au coin d'une maison grise, pour moi Gap sera toujours grise, je pleure. Je ne pleure pas, je sanglote. Maman va partir, Maman s'en va. Elle nous laisse. Elle me laisse. Il fait froid, je grelotte dans cet angle venteux. Bientôt, ce sera Noël. Sans eux, qui vivent au chaud, en Afrique. Cette petite fille, dans le lointain de ma mémoire, agitée de larmes et de froid, c'est moi. Ça y est, elle monte en voiture. Elle pleure. Un dernier geste de la main à travers la vitre. Elle n'est plus là, ni ses rires, ni ses baisers, ni ses chansons. A nouveau, je suis abandonnée.
Je me souviens. J'ai 10 ans. C'est Noël. Le premier avec nos parents. Parce que nous sommes plus grandes et moins fragiles, ils nous ont ramenées en Afrique. Au matin, la salle à manger est fermée. La porte s'ouvre. Une pièce illuminée. Tout au fond, un immense filao travesti en sapin de Noël, et dans tout l'espace, des paquets, des paquets, des paquets. Tout ce dont des enfants peuvent rêver, même la boîte à couture si désirée depuis longtemps. Au fond de ma mémoire, deux fillettes émerveillées, aux rires enchantés, et les visages heureux de nos parents.
Ces images si antinomiques, je les conserve soigneusement. Elles se répondent comme dans un miroir inversé. Avec elles, sur elles j'ai construit ma vie : il y a un temps pour tout, un temps pour le désespoir et un temps pour l'espoir, un temps pour le malheur et un temps pour le bonheur.
Demain est un autre jour, tout ira mieux après.
Fab
L'interro
Je me suis levé tôt pour réviser. Il y aura une interro d’maths c’est sûr ! Et peut -être un contrôle de géo !
D’après ce qu’a dit le prof’ la semaine dernière, ça va arriver. Je ne sais pas encore tous les noms des républiques soviétiques, faut qu’je révise, l’Ouzbékistan, le Truckistan, non, c’n’est pas bon ça !
Bon, tant pis, j’ai plus le temps de réviser, faut y' aller.
Hé ! un chien qui court vers moi, il a l’air agressif. Je cours avec difficulté vers le lycée, j’n’arrive pas à courir. Si ! Je passe le portail, il ne me suit plus.
Le prof’ de maths, distribue les copies, dix problèmes ! Faut gérer, je comprends rien, j’ai chaud, ah ! Si ! une question facile, c’est noté sur 20, j’aurai déjà deux points, ça suffit pas !
Faut s’relire, non j’attaque les autres. Je comprends rien.
Qu’est- ce qui se passe, les autres écrivent, pas moi. J’n’arrive pas à comprendre l’énoncé. Deux sur vingt ça n’va pas l’faire !
BRRRRRR BRRRRRRR
Le réveil !
En sueur.
Ouf ! C’était encore ce cauchemar d’école !
Ben
La boîte à boutons
Par endroits effacés, les motifs patinés de la boite à boutons. La boîte à boutons de ma mère ?Peut-être avant, celle de ma grand-mère, il y a des transmissions. Des transmissions qui ne disent pas leur nom. Il faut savoir, être dans leurs secrets.
Mes secrets sont ailleurs.
La boîte à boutons de ma mère. Le couvercle est retourné sur la grosse table devant la fenêtre. La pile de vêtements à repriser, boutons perdus à remplacer. Je sens l’odeur chaude des bûches qui s’enflamment. Cette année pas de chêne, que de l’amandier. Beaucoup ont gelé les années précédentes. La porte du poêle en fonte qui claque. Le loquet ajusté d’un petit coup de tisonnier. Mon père reprend sa pipe et son journal.
Glissements de boutons. Le doigt cherche dans la boite, fait glisser les boutons. Le bruit du doigt dans la boîte, doucement, pour ne pas déranger le désordre secret des boutons. Quand on prend la boite à boutons, avant de l’ouvrir, il y a toujours l’espoir de le trouver posé, juste sur le dessus, celui qui va aller, sans le chercher. Peut-être celui qui était tombé. Le bouton qu’une main aurait ramassé et hop dans la boite à boutons pour le jour où. Pour le jour où il faudrait le trouver. Moment magique, on le trouverait.
Les boutons juste écartés, il est peut-être dessous, juste en dessous. Glissements de boutons. Les bords des boutons sont arrondis, comme usés, c’est lisse, ça glisse dans la boîte à boutons. Les boutons glissent les uns sur les autres, petits bruits glissés un peu amplifiés par la boîte métallique. Au bruit, elle est bien pleine.
Mais la magie des boutons, c’est quand même de la magie, ça ne marche pas toujours, il faut y croire. Le doigt n’y a pas cru. Le bouton n’est pas là.
Peut-être plus au fond. Le doigt plonge dans la boîte. Faire remonter le bouton caché, le doigt en crochet.
Ouille ! Le doigt dans la bouche. La pulpe de l’index pressée contre le pouce, une perle rouge au bout du doigt. La bouche suce la goutte salée. L’aiguille oubliée, l’aiguille en embuscade au milieu des boutons.
On sait bien qu’elle est peut-être là, mais on n’y croit pas, pas cette fois. Enfin, le doigt n’y croyait pas ou bien il avait oublié. Oublié la dernière fois où il s’était piqué dans la même boîte. Le doigt était sûr de l’avoir rangée. Il devait y en avoir une autre ou bien elle est revenue…
La boite est renversée sur la table. Ça finit toujours comme ça. Une cascade de boutons, un ruissellement et puis le silence. La main à plat, du bout des doigts. Glissement de boutons. Tiens, elle est là. Une vraie petite aiguille, encore enfilée. Une aiguille à bouton. J’imagine ma grande sœur. Un bouton à la va-vite, assise sur une fesse, juste avant de sortir. Pas le temps de retourner à la boîte à couture. La main pressée a posé l’aiguille dans la boîte à boutons, juste au-dessus des boutons. Au moins elle ne la chercherait pas la prochaine fois. Quelqu’un aura déplacé la boîte, un peu secoué. L’aiguille se sera cachée. Au milieu des boutons. Elle attendait un doigt.
Du bout des doigts, ma mère cherche le bouton. Celui-là ou un autre, celui qui ira, qui ira à peu près. Parce qu’un bouton de braguette c’est pas grave, il est caché par la patte. Il suffit qu’elle soit bien fermée la braguette, que ça ne baille pas en s’asseyant.
Sur les genoux de ma mère mon pantalon attend son bouton. Pantalon gris rayé, en flanelle doublée. Le pantalon du grand-père, retaillé. Mon premier pantalon long.
Honte de mes culottes courtes. Le dernier à venir au collège habillé comme ça. Comme les minots.
J’étais fier de mon premier pantalon long. Je ne voulais plus le quitter. Enfin, je ne voulais plus retourner au collège avec mes culottes courtes. Le jour où ma mère l’a lavé. Je n’avais que celui-là avec les jambes longues. Alors le matin je l’ai décroché de la corde à linge et je l’ai enfilé, encore mouillé, raide de givre.
Il était épais le pantalon du grand père, retaillé. Je l’ai gardé mouillé toute la journée. Le soir quand je suis rentré il était sec, sauf à la ceinture et aux revers.
- « Pourquoi tu as mis ce pantalon ce matin, il n’était pas mouillé ? Tu en avais d’autres. »
- « Non Maman, il était sec. »
Alors vous comprenez pour la boîte à boutons ? C’était important qu’elle remplace le bouton de la braguette. Elle pouvait bien mettre le premier qui lui viendrait mais je ne voulais pas remettre mes culottes courtes.
- « Maman, ne t’embête pas, n’importe quel bouton… enfin, pas rose quand même.»
Yves
Rentrée 2016/2017, ce qu’il nous reste d’un été
23 septembre 2016
Eté 2016
7 juillet 2016. Les enfants vont venir se baigner. Il fait très beau, très chaud. Le pays ne se remet pas de l'attentat de Nice, les politiques jouent la surenchère démagogique, les journalistes traquent les familles de victimes, les rescapés. Les musulmans se dédouanent en affirmant le rejet des extrémistes, en dénombrant leurs morts. La télé, la radio, les journaux ne parlent, ne montrent ad nauseam que ça. Relégués aux oubliettes de l'information, les attentats en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Afrqiue, des milliers de morts, les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe, se noyant par centaines, les millions de déplacés déstabilisant des continents entiers. Les Français n'ont d'yeux que pour les 87 morts de Nice. Leur univers nombriliste se referme sur eux. Des portières de voitures claquent, voici toute ma famille réunie autour d'un barbecue. A table on ne parle pas du drame, parce qu'il y a les petits. Joseph sort de l'eau, s'assied à côté de moi : "Teta, pourquoi il y a des gens méchants qui font ça ?". Dans ses yeux, il y a de la peur, le besoin de comprendre, le sérieux de la situation l'affecte malgré l'omerta des adultes devant lui. Comment expliquer l'horreur, la folie à un enfant de sept ans, hyperprotégé, qu'on fait vivre dans un monde de bisounours. Ma tentative de réponse maladroite, très maladroite, ne semble pas le rassurer. Heureusement sa soeur et sa cousine l'appellent pour se baigner encore. Il se lève et court vers elles, joyeux, délivré de l'univers des grands.
Fabienne
Dans les gorges oubliées, le véhicule roule. Les parois sombres plongent dans le torrent qui brasse des eaux grises. L’été est là, pourtant : sur les pentes les mélèzes sont verts et une tache bleue, comme perdue, s’étale au-dessus de ma tête. Et le soleil enfin, au bout du défilé, l’espace retrouvé, la respiration qui repart à son rythme et le village, enfoui pendant des décennies dans les brumes de ma mémoire, qui réapparaît. Eté 2016, je ne reconnais pas les chemins empruntés avant. Le Chien m’accompagne. Il court, il sent, il tient la piste. Il est chez lui. Il s’arrête et m’attend. Dans son regard profond, je vois se rejoindre le passé et le présent. Il va et je le suis, dans ce Haut Lieu du tourisme d'où sont bannies les voitures. Sur les coteaux abrupts où l’on faisait les foins, se dressent des chalets. Le chien, en avant-garde, s’est jeté et s’ébroue dans la fontaine en bois qui fait toujours couler son eau. Il fait chaud. Des touristes s’arrêtent pour goûter la fraîcheur offerte et fixer, sur la pellicule, le balcon fleuri qui les a séduits. Je vais avec mon compagnon canin à la recherche d’une maison, d’un nom… Boutiques de souvenirs, sculpteurs sur bois… Mais où est donc passée la petite épicerie du village ? « Mais où sont passées les neiges d’antan ?... » La neige, il y en a toujours, car sur l’alpage on a planté des poteaux de remontepente. Honneur au ski… Mon guide tourne autour de moi. Que veut-il ? Dans le gouffre insondable de ses prunelles, je lis comme une attente. Je regarde et je vois : l’église… un repère de la vie antérieure, de l’immuabilité dans un monde qui bouge et qui voit le paysan devenir hôtelier, l’épicerie, en son temps fort utile, vend, désormais, le rêve des artisans du lieu. On peut restaurer, embellir, mais on ne peut et on ne doit pas tout détruire. L’Église, le Temple en contrebas, et les anciennes maisons se doivent d’exister, contre-point essentiel au néo-folklore paysan de pacotille. Le Chien et moi avons suivi la ruelle. A la sortie du village, la Nature a repris ses droits : les mélèzes se sont multipliés et dispensent sous leurs rameaux agités une fraîcheur agréable, à quelques mètres seulement, une marmotte se dresse. « Mon bon Chien, dis-moi : Pourra-t-on profiter, encore longtemps, des bienfaits des hommes et des beautés du monde ? »
Josette
Nice, juillet 2016
La chaleur écrase la ville depuis le lever du jour. Chaleur de plomb, étouffante comme la violence de l’attentat de Nice ce 14 juillet 2016. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc, à l’arrêt du tram. A t-il appris la nouvelle ? A-t-il entendu parler les passants ? Il ne bouge pas, il ne frémit pas, perdu dans un ailleurs inconnu de tous, inconnu de lui peut-être. Depuis le matin, je le regarde, je l’observe, je l’épie même, depuis ma fenêtre, pour oublier la nouvelle. Je l’ai apprise hier à minuit, la nouvelle. Au retour de la fête pour l’anniversaire de Samira j’ai allumé la télévision, machinalement. A cet instant j’ai souhaité être sourde et aveugle. J’ai éteint la télévision aussitôt après. J’étais transie d’horreur. Cette folie engendrée par l’oppression, l’humiliation, cette folie attisée par les discours de haine, cette folie meurtrière ravive mon sentiment d’impuissance. J’enrage de constater l’inutilité de nos luttes antiracistes, l’échec de notre engagement militant, l’écrasement de notre idéal politique, des décennies plus tard. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc. Il semble ne pas voir les trams défiler, ni les voyageurs s’agglutiner aux portes ouvertes de la rame. Il semble ne pas entendre le vacarme qui l’entoure. La tombée du soir n’apporte aucune fraîcheur. Deux heures du matin, l’homme au regard bleu s’allonge sur le banc. Enfin, il s’endort.
Lili
Nice, juillet 2016
23 septembre 2016
La chaleur écrase la ville depuis le lever du jour. Chaleur de plomb, étouffante comme la violence de l’attentat de Nice ce 14 juillet 2016. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc, à l’arrêt du tram. A t-il appris la nouvelle ? A-t-il entendu parler les passants ? Il ne bouge pas, il ne frémit pas, perdu dans un ailleurs inconnu de tous, inconnu de lui peut-être. Depuis le matin, je le regarde, je l’observe, je l’épie même, depuis ma fenêtre, pour oublier la nouvelle. Je l’ai apprise hier à minuit, la nouvelle. Au retour de la fête pour l’anniversaire de Samira j’ai allumé la télévision, machinalement. A cet instant j’ai souhaité être sourde et aveugle. J’ai éteint la télévision aussitôt après. J’étais transie d’horreur. Cette folie engendrée par l’oppression, l’humiliation, cette folie attisée par les discours de haine, cette folie meurtrière ravive mon sentiment d’impuissance. J’enrage de constater l’inutilité de nos luttes antiracistes, l’échec de notre engagement militant, l’écrasement de notre idéal politique, des décennies plus tard. L’homme au regard bleu est là, assis sur le banc. Il semble ne pas voir les trams défiler, ni les voyageurs s’agglutiner aux portes ouvertes de la rame. Il semble ne pas entendre le vacarme qui l’entoure. La tombée du soir n’apporte aucune fraîcheur. Deux heures du matin, l’homme au regard bleu s’allonge sur le banc. Enfin, il s’endort.
Lili
Mai 2016, écrire à Bages
10 juin 2016
Lettre à l'ange
Bages, le 28 mai 2016
Ange, mon ange,
Où te cachais-tu ?
Hier soir, sortie de cinéma, impossible de remettre la main sur mes clés de voiture. Retourné les poches intérieures de mon sac, trop grand. Fouillé ses fentes. Le grand cirque. Croisé les doigts, invoqué ma bonne étoile : pas plus d'ange gardien que de trousseau de clés.
Inutile de vilipender ma légendaire distraction, de revendiquer mon droit à la fantaisie, le contenu de mon sac répandu sur le trottoir, c'était juste bon à faire fuir les Sigisbée de tous poils. C'est un baragouineur de première qui est venu à mon secours. Pas le genre à vous faire croire au printemps au cœur de l'hiver, ni à vous faire grimper en montgolfière, mais le chenapan, « Mademoiselle, je suis sûr que je peux faire quelque chose pour vous », a-t-il dit, penché sur le fatras « jeté de sac », a tiré d'en dessous de mon porte-cartes, coincé entre mon porte-monnaie et mon paquet de cigarettes à moitié vide, le porte-clés, au bout duquel pendaient mes clés. « Ce que vous cherchiez » ? a-t-il interrogé, l'air à peine rigolard.
Le fatras a réintégré mon sac, définitivement trop grand, et vexée comme un psyllé, j'ai arraché des mains de l'homme, mon trousseau - il sentait la misère et des pieds- pris mon sac sous le bras, mes jambes à mon cou et retrouvé ma voiture dans le parking. Du premier coup. Ouf !
Merci mon ange !
Josianne
Bages, le 29 mai 2016
Chère inconnue,
Votre message découvert ce matin dans ma boite aux lettres me laisse rêveur. Lettre sans timbre déposée par une main discrètement parfumée.
Je ne vous connais pas mais votre histoire a fait courir mon imagination. Votre sourire en sortant du cinéma, le film vous a plu. Le sourire volé par la main qui s’énerve et qui ne trouve pas. Le rouge sur vos joues. Votre sac rageusement répandu sur le trottoir. Votre silhouette accroupie sous le réverbère. La fouille fébrile dans les plis du sac vide dérangeant quelques effluves de votre parfum. Votre inquiétude à l’approche de ses pas. Votre menton volontaire pointé vers lui pour lui montrer que vous n’avez pas peur et lui interdire de s’imaginer des choses. Votre cœur qui bat quand même beaucoup trop vite. Votre bouche pincée devant les clefs tendues, sa main qui ne tremble pas. Vos talons précipités vers le parking. Votre soupir en vous asseyant dans la voiture, il ne vous avait pas suivie. Avec la sécurité retrouvée, un soupçon de regret peut-être… de l’avoir si mal jugé ? Qui était-il vraiment ? Odeur de misère et de pieds ou un remugle de caniveau ?
Je comprends votre trouble qui vous a fait choisir ma boite aux lettres plutôt que celle de votre ange et qui vous a fait écrire machinalement au dos de l’enveloppe votre nom et adresse.
Je viendrai donc lundi à 19 heures, j’en aurai le cœur net. Votre ange serait-il une réalité ou une bouteille à la mer ?
Un ange à peine réel et solitaire qui pourrait bien être le vôtre.
Yves
Où il est question d’un p’tit bonhomme…
10 juin 2016
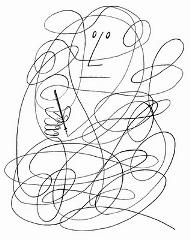 Je suis un âne
Je suis un âne
J’ai pensé que c’était dommage de ne pas en profiter mais le temps s’écoulait.
La chaise craquait, on voyait que la table avait bien vécu, un rayon de soleil sur le tapis iranien, le chat qui passait, un stylo, un cahier. Un cahier vide et ma tête. Ma tête pleine qui n’arrivait pas à associer ces mots, faire naître une idée, le début d’une histoire, une histoire qui ne serait pas venue de moi. Elle devait bien être quelque part cette histoire qui n’arrivait pas. Une histoire de temps, d’un autre temps, d’un temps perdu. Avec une belle fin, élégante.
Rien. Le vide. J’aurais mieux fait d’aller courir.
J’ai regardé sur mon épaule…
Pourtant les images se bousculaient. Un paquebot dans la nuit. Un contre-jour indiscret. Une chemise de nuit. Un atelier bruyant et sale. Un chahut d’ouvrières en blouse, visages maculés. Un chemin de douanier. Un pianiste dans le salon de première, le salon vide. Un phare dans la tempête. Une passagère égarée dans les coursives en chemise de nuit. Un piano droit. Une table qui en a vu. Un fauteuil de théâtre cassé. Un soutier noir hilare, torse luisant, une pelle à la main. Le pianiste en tenue de jazzman sifflotant dans la coursive. Des personnages arrivaient, ils s’en allaient, sans s’arrêter. D’autres restaient, commençaient leur histoire et puis plus rien. Paralysés. Muets. Plus aucune pensée. Inutiles.
J’ai regardé sur mon épaule… d’habitude il venait, là.
J’ai rassemblé mes jambes sous moi, toute mes forces, prononcé des formules magiques, cherché des exemples, convoqué les ancêtres, éteint et rallumé les lumières.
J’ai invité les pensées que j’aime, celles qui ne m’ont jamais laissé tomber. Evoqué mes fantasmes, des situations embarrassantes, mes rencontres étranges, pour qu’il vienne sur mon épaule, qu’il me raconte une histoire.
Rien, pas un bruit, pas une odeur. Les mots sont restés vides.
J’ai regardé sur mon épaule… Pourtant il ne m’avait jamais lâché… Enfin, jusqu’à ce matin.
J’ai bu un autre café, croqué une autre pomme.
J’ai ouvert toutes les portes, cherché le mouvement.
J’avais juste besoin d’un petit mouvement, un mouvement de rien du tout. Un souffle, un coup de vent, une robe, un chapeau, n’importe quoi, mais que ça vole.
Rien n’a bougé. Chapeau vissé et robe sage.
Je me suis dit que rien n’était irréversible, que j’allais me débrouiller sans lui. J’ai pris mon temps.
Du bout des doigts j’ai effleuré le cahier. Le stylo tournait entre mes doigts, lamentable. Je l’ai posé.
- « Mais où tu es petit bonhomme? »
J’ai regardé sur mon épaule… rien.
J’ai regardé mon autre épaule. Il était là, tranquille, même pas essoufflé.
- Je lui en voulais : « Tu es en retard petit bonhomme…
- « Ouais, » qu’il m’a dit, « Néanmoins il y a des choses qui se comprennent facilement. »
- Là, j’ai explosé : « Fais pas le malin ! Tu m’as laissé tomber… Pourquoi tu as fait ça ?»
Le petit bonhomme m’a souri, de toute sa gentillesse :
- « Tu crois que tu as écrit ça tout seul ? Tiens, il te manque le titre. Arrête de râler, prends ton stylo, écris. Tu y es ? Ecris ton titre : … Je suis / un âne. »
Yves